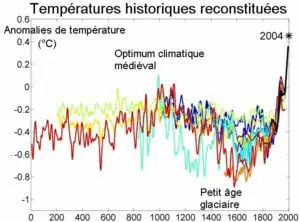Comment ne pas revenir un instant sur la naissance du protestantisme et les raisons qui président à la création de cette nouvelle confession de la religion chrétienne, qui constitue un schisme comme encore jamais l’Europe n’en avait connu depuis la naissance du christianisme puis la scission des Églises d’Orient et d’Occident de 1054 ?
Suite à la diffusion des idées de Martin Luther puis de Jean Calvin, l’Europe du XVIe siècle voit en effet s’affirmer une nouvelle religion, en rupture avec l’Église romaine et la Papauté, mais plus encore que cela porteuse d’une nouvelle philosophie et spiritualité impactant tous les compartiments de la vie publique et quotidienne. L’enracinement du protestantisme, en particulier dans les pays d’Europe de l’Ouest et du Nord ainsi que dans certaines régions de France, provoqueront nous allons le voir des mutations profondes des rapports aux questions spirituelles et religieuses, mais aussi plus fondamentalement économiques, sociales, culturelles et politiques. L’arrivée de la religion réformée constitue de fait l’un des plus grands tournants de l’Histoire de l’Europe moderne, et il est peu dire que le continent ne sera, après cela, plus jamais le même. Le Vieux Continent se voit désormais divisé en deux grands espaces socioculturels, entre Europe protestante du Nord et Europe catholique du Sud. Autant de puissances et d’États modernes qui, après s’être déchirés au travers de terribles « guerres de la Religion » internes, vont développer des trajectoires sensiblement différentes (et entrer globalement et pour longtemps en grande tension et rivalité structurelles).

(©rédit illustration : World History Enclyclopedia)
Dans ce petit article extrait de ma grande série sur l’histoire (vraie) de la Bête de la Gévaudan, je vous propose ainsi de revenir sur les tenants et aboutissants de la Réforme, de ses origines et des raisons de sa survenue historique dans le contexte de l’Europe de la Renaissance, puis sur ses conséquences à moyen/long terme en matière d’évolution culturelles et sociétales, et de constater le nouveau paradigme qu’elle installe dans l’Europe du début de l’ère moderne (qu’elle a structurellement participée à façonner). Bonne lecture !
31 octobre 1517, cathédrale de Wittemberg, Allemagne. Un jeune prêtre allemand du nom de Martin Luther vient de placarder sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg ses « 95 thèses » contre les indulgences – ces rémissions des péchés accordés aux fidèles par les prêtres catholiques contre de l’argent. La critique n’est pas nouvelle. Mais par l’un de ces jeux d’engrenages dont l’Histoire a le secret, la contestation va s’emballer, et ce simple acte de dissidence donner naissance à une nouvelle confession de la religion chrétienne.
Qui est Martin Luther ? Et d’où prend racine sa contestation des pratiques de l’Église romaine et de la Papauté ? Pour le comprendre, il nous faut comme d’habitude rembobiner un peu la cassette, et dresser le portrait de la Chrétienté du début du XVIe siècle – une Chrétienté encore marquée par les hérésies du Moyen-Âge (Cathares, Vaudois,…) et traversée en profondeur par les idées nouvelles de la Renaissance…
* * *
Au début de la Renaissance, un désir ancien (et croissant) de « réformes » de l’Église catholique…
Les luttes du siècle précédent, le schisme d’Occident, la licence des mœurs parmi les clercs, la simonie, la vente des bénéfices et des indulgences, tout cela avait affaibli l’Église et diminué la Papauté. De toutes parts on se levait contre elle. On proclamait l’autorité du concile supérieure à celle du Pape. On faisait des distinctions entre l’Église universelle qui est infaillible et l’Église romaine qui est capable d’errer. Les séculiers et les réguliers se disputaient, des voix s’élevaient demandant un changement. « Il faut moraliser le clergé », avaient déjà dit les Pères du synode de Vienne (1311). Après eux, on déclara qu’il fallait réformer « la tête et les membres ». Déjà le mouvement des Hussites, celui des Frérots, des Fraticelles, des Beggards, avaient été une protestation contre les richesses et la corruption de l’Église, mais la Papauté était impuissante à réformer, et la Réforme devait se faire en dehors d’elle et contre elle.
Bernard Lazare, L’antisémitisme : Son histoire et ses causes, p. 138
La contestation de l’Église de Rome, de sa doctrine et de la structuration de la foi chrétienne qu’elle promeut (et impose) est à vrai dire aussi vieille que le christianisme. Dès la mort de Jésus Christ pour ainsi dire, ses apôtres et ses fidèles étaient partagés quand à la suite à donner à son magistère terrestre : faut-il former une nouvelle religion basée sur la Parole du Christ (et si oui, laquelle ?), ou bien se contenter de réformer le judaïsme de ses enseignements ? Il y aura autant de réponses qu’il n’y a de sensibilités locales, et bientôt, des centaines si ce n’est des milliers « d’écoles » et de « sectes » (le terme n’est alors pas péjoratif et désigne une communauté de foi) vont fleurir partout dans le monde romain, essentiellement au sein des communautés juives disséminées tout autour du bassin méditerranéen.
Deux grandes tendances vont rapidement se distinguer : il y aura les tenants des apôtres Pierre et surtout Paul (un juif converti au christianisme plusieurs années après la mort de Jésus et qui va se faire le champion de la nouvelle religion), qui vont œuvrer à la mise en place d’une nouvelle religion ad hoc, d’essence verticale et centralisée, et basée sur leur interprétation (partielle et partiale il faut bien le dire) du message christique ; et les sectes dites « gnostiques », marquées par l’influence des écoles à mystère de l’Antiquité, de la pensée pythagoricienne et platonicienne, et au sein desquels circulent notamment d’autres Évangiles et textes attribués à Jésus et à ses disciples (en particulier Thomas, Philippe et Marie-Madeleine – textes qui ne seront pas reconnus par le canon biblique lorsque celui-ci se structurera au IVe siècle). Durant les premiers siècles de son existence – et ceci est très important à retenir car cela est trop oublié aujourd’hui ! –, il y a donc autant de courants et de variantes du christianisme (ou plus exactement de “foi” et de mouvements religieux inspirés de la parole de Jésus et de ses disciples) qu’il n’y aura plus tard de mouvances et de sous-mouvances du protestantisme. Pour ne citer qu’eux : donatisme, macédonianisme, nestorianisme, monophysisme, pélagianisme, iconoclasme, gnosticisme dans toutes ses variantes,… avant que n’émergent également à partir du IIIe siècle deux nouvelles tendances importantes que vont être le manichéisme – une sorte de syncrétisme entre christianisme et zoroastrisme baptisée du nom du prophète perse Mani (et dont le catharisme sera près d’un millénaire plus tard une lointaine résurgence !) – et l’arianisme (une scission au sein du courant chrétien majoritaire quant à la question de la divinité de Jésus). La tendance dominante demeure néanmoins celle issue de « l’église de Pierre et de Paul », et celle-ci va œuvrer durant ces trois siècles à affirmer son orthodoxie, en qualifiant toutes les autres mouvances d’« hérésies » et en les combattant farouchement.

Mais au-delà de ces conflits pour ainsi dire « internes », c’est surtout la décision par les empereurs romains (alors confrontés à diverses crises économiques et politiques profondes) de faire du christianisme « orthodoxe » la nouvelle religion d’État qui va véritablement marquer le grand tournant de l’Histoire du Christianisme, et faire de ce dernier la nouvelle confession hégémonique du monde romain (puis plus tard européen). C’est d’abord l’empereur Constantin qui va mettre fin aux persécutions des Chrétiens et organiser le célèbre concile de Nicée (325) qui en établira l’orthodoxie, avant que son successeur Théodose n’en fasse la nouvelle religion officielle de l’Empire et n’achève d’en fixer la doctrine et le mode d’organisation via le concile de Constantinople de 381 (c’est à ce moment que sont ainsi arrêtés les grands principes du futur dogme catholique, avec notamment la définition des quatre Évangiles canoniques, le principe de la Sainte-Trinité, les rites liturgiques, les dates des fêtes religieuses comme Pâques, etc.).
Les siècles qui suivent ne sont que la longue histoire (que nous ne développerons pas ici car elle constituerait un article à part entière… !) de la diffusion et de l’enracinement du christianisme désormais dit « nicéen » (au sens de conforme au dogme établi lors des conciles de Nicée) à l’ensemble du monde « païen » (en particulier de l’ouest et du nord de l’Europe), long processus au cours duquel celui-ci va pénétrer – de gré ou de force – jusque dans les profondeurs des campagnes et y supplanter (tout en les assimilant en partie) toutes les anciennes croyances des populations (qui se perpétueront néanmoins sous la forme d’une grande variété de traditions). Au-delà de ce long et lent phénomène de christianisation des « païens » qui va se dérouler sur des siècles et des siècles, les autorités de l’Église nicéenne (et notamment son autorité centrale, la Papauté, qui s’est structurée à partir de la chute de l’Empire romain d’Occident et dont elle a en quelque sorte remplacé la figure tutélaire) n’auront de cesse de lutter parallèlement contre tous les autres courants concurrents du christianisme, certes devenus largement minoritaires, mais qui continueront néanmoins de se maintenir ou de réapparaître ici et là, encore loin dans le Moyen-Âge. À l’époque médiévale, les plus fameuses de ces « hérésies » seront sans conteste le catharisme et le bogomilisme. Nous ne ferons pas ici l’histoire des Cathares. Mais il est peu dire que la répression d’une violence inouïe de ces « parfaits hérétiques » marquera les consciences, et constituera un profond traumatisme au sein du Languedoc médiéval, dont l’économie et la culture brillante et rayonnante (on pourrait même parler de « civilisation occitane ») ne se relèveront pour ainsi dire jamais.
De façon générale, tout au long de l’Histoire médiévale, l’Église romaine va s’affirmer comme un pouvoir de plus en plus central et hégémonique (tant vis-à-vis des croyants que des pouvoirs laïcs – rois, seigneurs, etc. – qu’elle entend aussi lui voir subordonnés). Ne tolérant aucune concurrence spirituelle au sein de son giron européen, cette même Église combattra très durement toutes les « hérésies » remettant en cause son autorité (politique comme morale), ce dans une logique très « impériale » qui a pu inviter certains historiens à la voir comme une sorte de perpétuation de l’impérialisme romain sous une autre forme (en l’occurrence religieuse et donc d’essence sociale et politique, quand l’Empire romain exerçait son contrôle aux moyens de leviers davantage administratifs et militaires – autrement dit : l’Empire romain régnait par le bâton des armes et la carotte des bénéfices de l’intégration (infrastructures, citoyenneté, etc.), quand l’Église exercera elle son règne en cherchant directement à contrôler les consciences). En France, Vaudois et surtout Cathares, bien que ne concernant qu’une minorité des populations locales, seront ainsi sévèrement réprimés, dans une véritable orgie de sang…
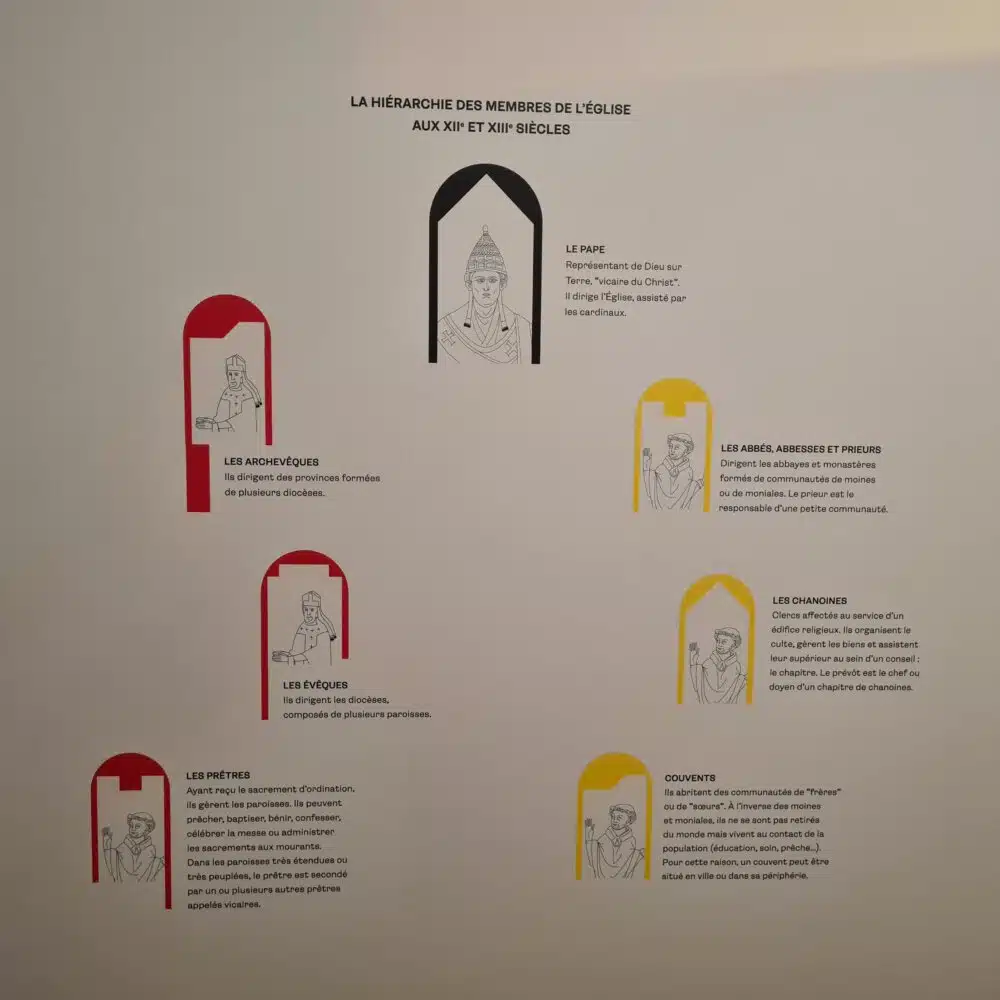
Au XIIe et XIIIe siècle, près d’un millénaire d’enracinement du christianisme en Europe de l’Ouest ont accouché d’une Église catholique (presque) toute puissante, adossée à une hiérarchie aboutie – que les historiens désignent parfois sous le qualificatif de « Théocratie pontificale ». En haut de cette pyramide ecclésiastique « trône » le Pape, désormais directement élu au sein de l’Église par les cardinaux. La Papauté est à ce moment devenue un véritable organe centralisé qui en plus de constituer l’autorité suprême du monde chrétien, administre ses propres États, produit du droit et peut légitimer voire être à l’initiative de guerres et de conflits considérés comme “justes” (un peu à l’image de l’ONU de nos jours), comme les célèbres « Croisades ». La Papauté a aussi reconquis aux seigneurs le pouvoir de nommer et révoquer les évêques, l’autorité qui gouverne les diocèses (c’est-à-dire la plus haute brique administrative du découpage ecclésiastique de l’Europe). Se placent également sous son autorité directe la majorité des milliers d’abbayes (gouvernées elles par des abbés) qui recouvrent tout l’ouest et le centre de l’Europe, de même que les grands ordres militaires comme ceux de l’Hôpital et du Temple (et plus tard les ordres mendiants). À cet organigramme déjà très solide viennent enfin s’ajouter les légats, qui représentent le pape sur le terrain et agissent en son nom. Ces derniers achèvent de maintenir une pression constante de l’Église sur les pouvoirs laïcs…

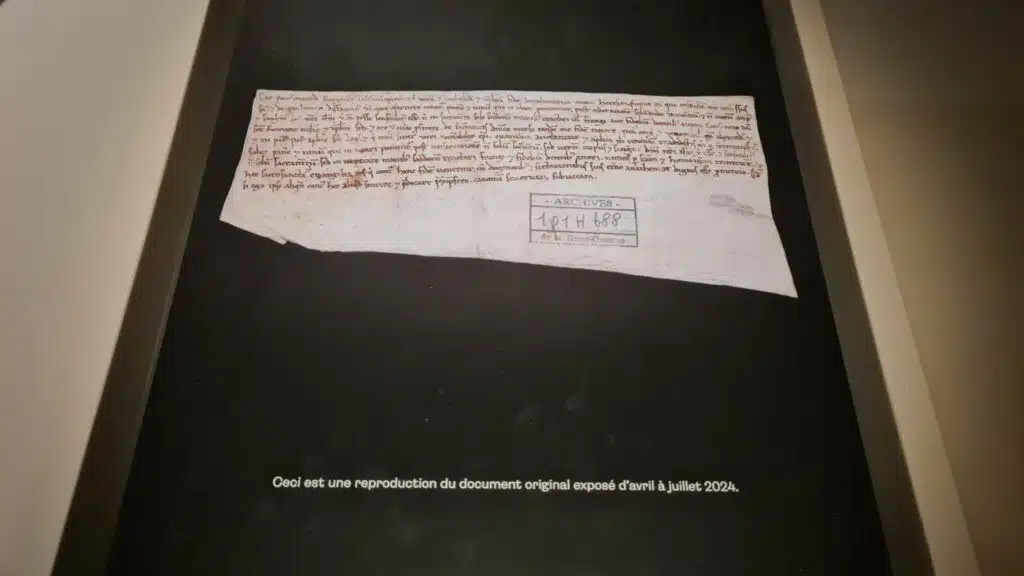


(© Archives municipales de Toulouse exposées lors de l’exposition Cathares – Toulouse dans la Croisade en 2024)
Zoom sur : la « religion des œuvres » de la fin du Moyen-Âge
Bien qu’ils demeurèrent tous relativement minoritaires, ces divers mouvements religieux chrétiens hétérodoxes (que l’Église désigna généralement par le mot secte » pour les discréditer) font écho à une réalité indéniable de l’Europe du Moyen-Âge : l’intensité de la vie spirituelle et des préoccupations religieuses et morales des populations de ce temps. Profondément chrétienne, l’Europe médiévale est en effet le lieu d’une société inquiète du séjour dans l’au-delà. Dès le XIIIe siècle, les sermons des prêcheurs ont inculqué au peuple la crainte du péché et du jugement de Dieu, des peines de l’Enfer et du Purgatoire. En ces temps, au sein de la population lambda, la crainte de la damnation éternelle en Enfer est bien réelle, de même que le passage par le Purgatoire (qui effraie en effet tout autant car il est dépeint par les clercs comme un « Enfer provisoire »). C’est à ce moment que l’Église catholique – qui fait ici il faut bien le dire à la fois les questions et les réponses… – a mis en place et promu tout un ensemble de pratiques de rachat de leurs pêchés par les fidèles, encadrées par le clergé : sacrement de pénitence (avec la confession détaillée des péchés au curé), indulgences, œuvres de charité, messes… Les grandes et terribles pestes du XIVe siècle, en suscitant une véritable angoisse collective de la mort et de l’au-delà, ont ensuite encore conduit à amplifier le mouvement. C’est à ce moment que ce que l’on a parfois désigné comme la « religion des œuvres » connaît son apogée, avec des chrétiens, clercs et laïcs conduits à multiplier les dévotions et les « bonnes œuvres » (charité, culte des saints, multiplication des intercesseurs, messes pour les défunts, processions, legs pieux, etc.) pour assurer leur salut.
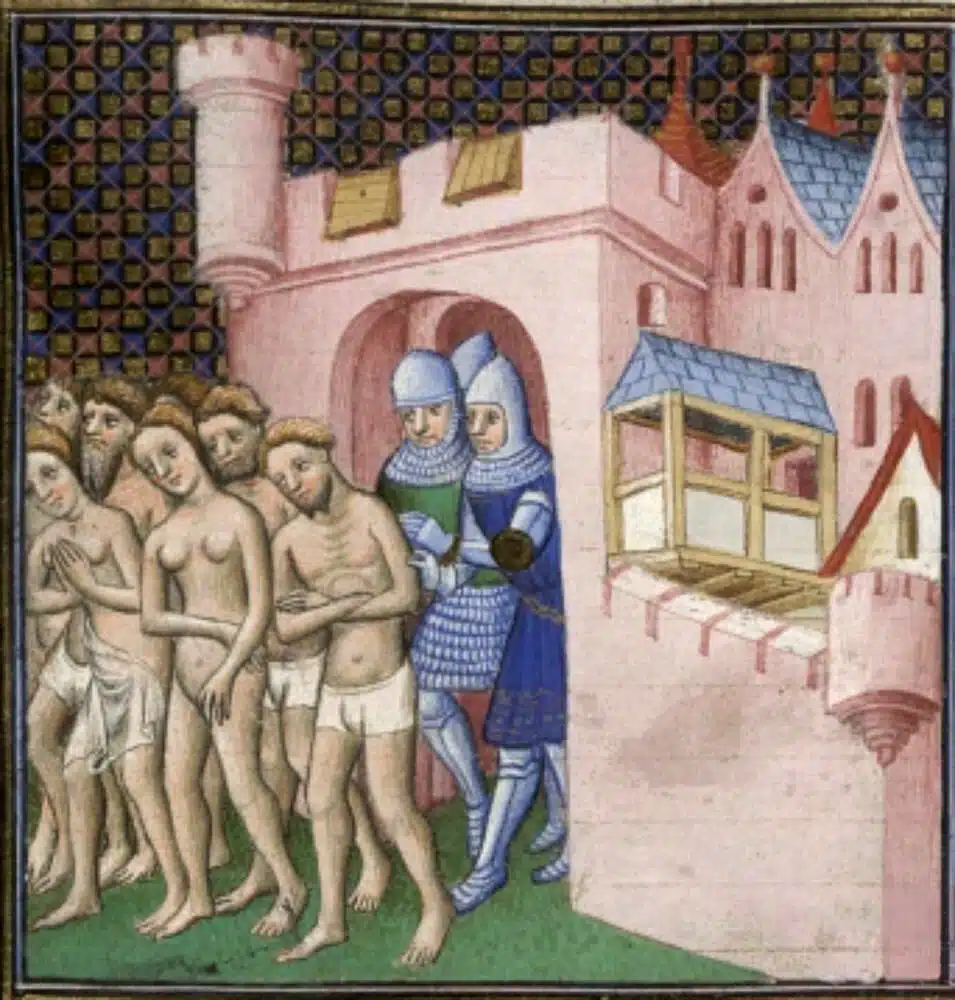
Pour garantir son accès au paradis, dans toute la société chrétienne, on « œuvre » ainsi à obtenir le salut de son âme, en faisant des dons à l’Église et en donnant aux nécessiteux pour les plus riches, et par la ferveur du culte des saints et par les pèlerinages pour les plus pauvres. L’Église et la Papauté se positionnent à ce titre comme promoteurs et complices actifs de cette surdévotion matérielle, en multipliant le commerce des indulgences et en offrant la vie éternelle et le salut à qui participerait à la croisade en Terre Sainte (ou contre les hérétiques…), ou à qui financerait les travaux de rénovation ou d’embellissements de telle ou telle église…
Dans cette tendance qui n’a fait que s’intensifier, le reproche qui est fait est donc que le salut de l’âme du Chrétien ne serait plus fondamentalement affaire de foi et de grâce divine (démarche relevant de la spiritualité et de la consciences propres à chacun), mais davantage de dons et de réalisations pratiques envers l’Église. Pour les grands critiques du commerce des indulgences que constitueront bientôt les protestants, celui-ci ne revient à rien de moins qu’à acheter le salut, la place au paradis, par des versements sonnants et trébuchants aux œuvres de l’Église et aux prêtres qui les gèrent (ce qui mènerait à leur enrichissement tout en augmentant leur tolérance envers ce qui est considéré comme un non-respect de l’évangile). Pour ses détracteurs, les actions réalisées dans le monde matériel semblent ainsi avoir pris, en rupture avec la piété promue par les Évangiles, plus d’importance pour l’Église catholique que celles relevant du monde spirituel. Et ce n’est pas, loin de là, la seule dérive qu’un nombre toujours plus élevé de contestataires reprochent au Saint-Siège et à son clergé…

En ce tournant du XVIe siècle, au sein d’une société chrétienne profondément soucieuse d’assurer son salut (et qui a ainsi vue se multiplier les dévotions – à la Vierge, aux saints, au « saint sacrement » … – et les bonnes œuvres), les vices qui caractérisent le fonctionnement de l’Église (et en particulier de la Papauté) ont parallèlement commencé à devenir intolérables à de nombreux croyants. Corruption, népotisme, orthodoxisme, bellicisme, intolérance, privilèges inouïs dans une société au fonctionnement féodal et gangrénée par les inégalités socioéconomiques,… les objets et motifs de reproches sont légion. L’élection et le comportement des Papes les plus récents, en particulier, ont tourné au scandale. Tout en haut de l’appareil ecclésiastique, les populations chrétiennes d’Europe semblent en effet assister au spectacle d’un haut clergé totalement corrompu – pape, évêques et cardinaux en tête ! (on peut se souvenir à ce sujet de la fameuse série télévisée Les Borgia, mettant en scène la réalité historique d’une famille de papes de père en fils et totalement amoraux…). Le pape Alexandre VI – Rodrigo de Borja, né Roderic Llançol i de Borja (1431-1503) – est il est vrai l’exemple le plus caricatural de cette dérive népotique de la Papauté. Élu par simonie (c’est-à-dire par achat de votes) en 1492, il est le père de pas moins de six enfants reconnus (il en aura huit de trois maîtresses différentes… !), dont les tristement célèbres Lucrèce et César Borgia (ce dernier servira d’ailleurs de modèle à Machiavel pour son livre Le Prince, César y représentant nul autre que le tyran…). Le pape Léon X (1513-1521), manquant d’argent pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome, se démarquera quant à lui en vendant en masse des indulgences (c’est-à-dire qu’il promet la rémission des péchés et le paradis) à quiconque en financera la construction.
Dans ce contexte d’une moralité douteuse au plus haut niveau de l’Église, la rigueur morale exigée par le petit clergé catholique envers les simples fidèles de tous pays semble ainsi devenue absolument insupportable – et précisément amorale. Le phénomène de contestation des pratiques de l’Église catholique prend à cet égard d’autant plus de vigueur que la période est traversée par un contexte culturel nouveau, marqué par de grandes mutations et innovations dans le champ socioculturel. En effet, l’arrivée de l’imprimerie (mise au point par Gutenberg vers 1455) a permis la multiplication rapide des textes (100, 500 ou 1000 exemplaires) – quand les ouvrages écrits n’étaient jusque ici produits qu’au compte-goutte par le patient travail des moines copistes. Cette nouvelle technologie a favorisé le développement des écoles, qui ont elles-mêmes entraînées dans les villes une part croissante d’alphabétisation. Cet essor remarquable des populations lettrées (en particulier au sein des classes supérieures de la société – nobles, bourgeois, artisans, commerçants, magistrats, etc.) entraîne à son tour une rupture culturelle, la lecture n’étant désormais plus réservée à l’élite que constitue le clergé.
La Réforme réussit, alors que les efforts de réforme antérieurs avaient échoué, principalement grâce à l’invention de la presse à imprimer vers 1440. Wycliffe et Hus avaient formulé un grand nombre de points identiques à ceux des réformateurs, mais ils ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour partager leur point de vue avec un public plus large. Les 95 thèses de Martin Luther furent popularisées par l’impression, tout comme ses autres écrits qui furent ensuite traduits et imprimés ailleurs, inspirant un mouvement plus large en dehors de l’Allemagne.
Joshua J. Mark, « Dix choses à savoir sur la Réforme protestante », article traduit par Babeth Étiève-Cartwright pour la World History Encyclopedia

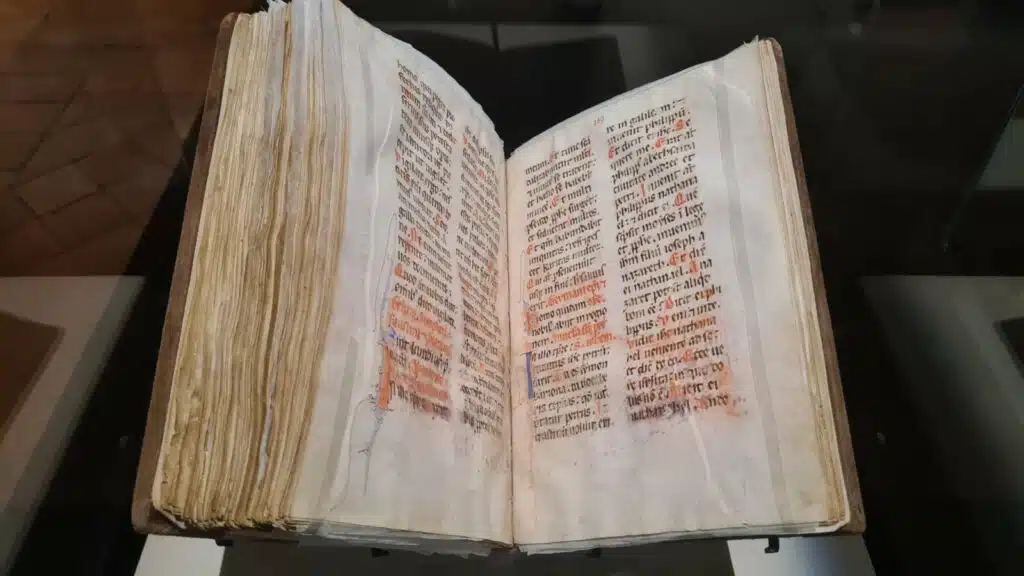

Ce phénomène d’alphabétisation et d’essor de la lecture se couple avec le mouvement humaniste, qui se développe parallèlement au tournant du XVIe siècle. Les humanistes (qui sont globalement des « littéraires ») puisent dans l’Antiquité pour y rechercher les textes les plus anciens, qu’ils étudient dans leur langue d’origine, pour retrouver le sens originel, débarrassé des commentaires traditionnels. Ce retour aux sources s’applique aussi aux textes bibliques, en hébreu et en grec. En 1516, le célèbre Érasme de Rotterdam (celui qui a donné son nom au programme Erasmus !) publie à Bâle le Nouveau Testament en grec, avec une traduction latine qui corrige la Vulgate (la version latine de la Bible). Le Hollandais va même encore plus loin, en appelant à l’ouverture de l’Évangile à tous les laïcs, par la multiplication des traductions de la Bible en langue « vulgaire » (c’est-à-dire en langue du peuple, et non plus seulement en latin) :
L’humanisme qui se répandit dans ce siècle de bouleversement planétaire, avait hérité de l’influence de la Scolastique, développée et enseignée dans les universités du Moyen Âge, qui visait à réconcilier la philosophie antique avec la théologie chrétienne. Les humanistes en avaient tiré une morale très critique à l’égard du pouvoir de l’argent. Les biens n’étaient que des moyens de s’épanouir en vue de gagner la vie éternelle. La propriété était un mal nécessaire. Travailler pour accroître ses richesses était un péché, on ne devait travailler que pour satisfaire ses besoins vitaux. La finance était immorale et infâme, et le commerce très mal vu : transformer pour revendre, c’était bien, mais acheter pour revendre, c’était mal ; la transaction idéale consistant à vendre au juste prix, et à prêter gratuitement. Deux conciles, à Latran en 1315 et à Paris en 1532, avaient condamné le prêt à intérêt. Cette Église-là dérangeait les colons, les marchands, la bourgeoisie montante.
Marion Sigaut, De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, p. 12
Les humanistes furent les promoteurs [de la Réforme]. Tout les détournait du catholicisme. Les Grecs de Constantinople fuyant les Turcs leur avaient apporté les trésors des littératures anciennes ; Colomb en découvrant le nouveau monde venait de leur ouvrir des horizons inconnus. Ils trouvaient là des raisons nouvelles de combattre la scolastique, cette vieille servante de l’Église. En Italie les humanistes devenaient sceptiques et païens, ils s’émancipaient en raillant ou en platonisant, mais en Allemagne le mouvement d’émancipation qu’ils contribuaient à créer devenait plutôt religieux. Pour vaincre les scolastiques, les humanistes de l’Empire [romain germanique] devinrent des théologiens, et pour s’armer mieux ils allèrent aux sources mêmes : ils apprirent l’hébreu, non comme Pic de la Mirandole et les Italiens, par une sorte de dilettantisme ou par amour de la science, mais pour y trouver des arguments contre leurs adversaires.
Bernard Lazare, L’Antisémitisme : son histoire et ses causes, p. 139
Ce sont ainsi ces changement sociétaux fondamentaux du début de l’ère moderne qui expliquent pourquoi les contestataires de l’ordre établi n’ont fait que se multiplier, et pourquoi un nombre toujours plus élevé de croyants appellent désormais de leurs vœux à une profonde réforme de l’Église catholique et romaine, afin de la rendre enfin conforme aux idéaux évangéliques.
* * *
Dans cette Europe profondément chrétienne, sans vouloir aller globalement jusqu’à la constitution d’Églises dissidentes telles que purent l’incarner les Cathares ou les Vaudois, l’aspiration aux « réformes » de l’Église (mais aussi de l’État) se trouve donc partagée par de nombreux Européens de toute l’échelle sociale (petit peuple, mais aussi papes, rois, princes, clercs et laïcs). Du milieu à la fin du Moyen-Âge, des penseurs et théologiens comme Pierre Valdo (1140-1217), John Wycliff (1330-1384), Jan Hus (1373-1415) ou encore Jérôme Savonarole (1452-1498) avaient d’ailleurs déjà émis de vives critiques du fonctionnement de l’Église et de la Papauté, et tenté d’insuffler un mouvement de réforme du catholicisme. Tous ont néanmoins fini pendus ou sur le bûcher pour leurs idées… (ils seront d’ailleurs ultérieurement considérés et reconnus par les Protestants comme des précurseurs !)
Les deux proto-réformateurs les plus connus sont le théologien et prêtre anglais John Wycliffe (1330-1384) et le prêtre bohémien Jan Hus (c. 1369-1415). Wycliffe inspira Hus, dont les efforts furent la force motrice des guerres hussites (de 1419 à 1434 environ) et de la Réforme de Bohême (de 1380 à 1436 environ), deux des premières tentatives de réforme. Martin Luther fera plus tard référence à Hus, exécuté en 1415 en tant qu’hérétique, en tant que modèle pour les chrétiens dans la recherche d’une véritable relation avec Dieu, fondée uniquement sur la foi et la propre interprétation des Écritures.
Joshua J. Mark, « Dix choses à savoir sur la Réforme protestante », article traduit par Babeth Étiève-Cartwright pour la World History Encyclopedia
NOTA BENE : QUI ÉTAIENT PIERRE VALDO ET LES VAUDOIS ?
À l’image des Cathares à la même époque, les Vaudois étaient pourchassés comme hérétiques depuis le XIIIe siècle. Leur nom se rattache à celui de Pierre Valdo (1140-1206), marchand lyonnais, prêchant l’évangile sans l’autorisation de l’église. En 1532, les prédicateurs vaudois se sont ralliés à la Réforme et ont financé (à hauteur de 500 écus d’or) l’édition d’une Bible en français.
En fait, il faut bien le dire, en ce tournant des années 1500, le mot « réforme » n’a évidemment pas le même sens pour tous. Faut-il revenir loin en arrière et tendre au rétablissement de l’Église primitive (et opérer ainsi le retour à la pureté supposée des origines – c’est-à-dire des temps apostoliques) ? Ou bien s’engager dans une simple rénovation ? Ou bien encore prendre le chemin de l’innovation ? La question demeurait assez ouverte, jusqu’à ce célèbre jour du 31 octobre 1517 où un moine augustin, notre fameux Martin Luther (1483-1546), placarda sur la porte de l’église de Wittemberg ses 95 thèses…
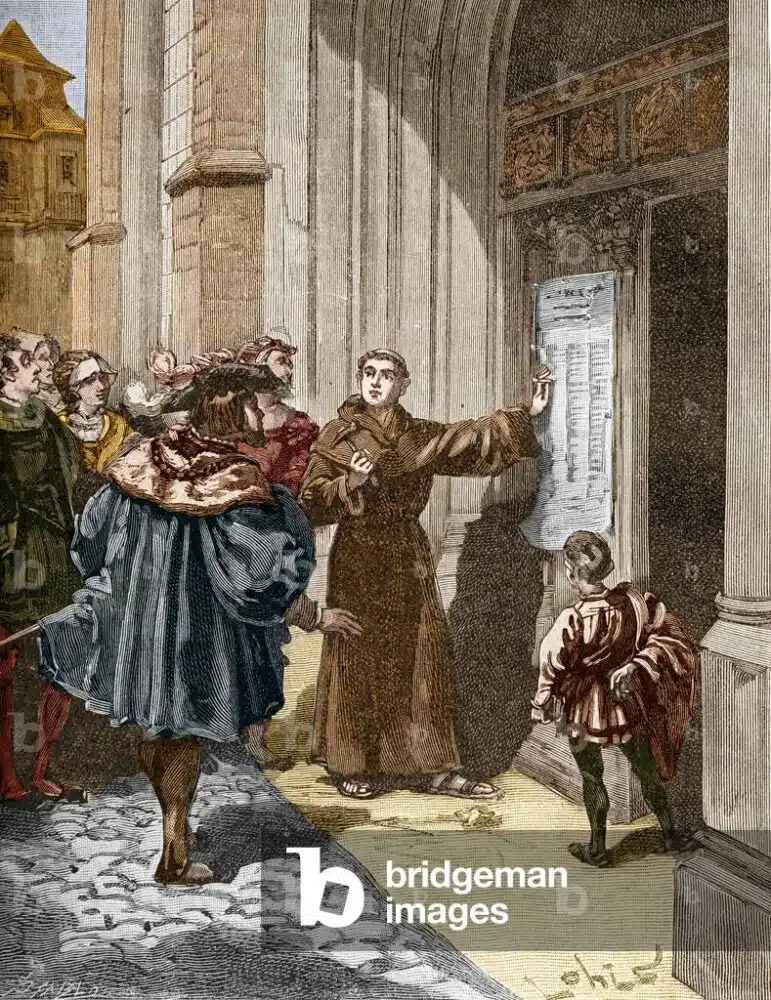
En ayant initialement la simple intention de réformer l’Église de l’intérieur (comme ses prédécesseurs partisans du changement), Luther va effectivement initier une rupture (qui prendra le nom de « Réformation ») – une rupture qui va prendre l’allure d’une réaction en chaîne. L’événement de Wittemberg aurait pu en effet s’arrêter à une révolte avortée, comme les précédentes. Cette fois, cependant – et cette fois pour de bon –, le processus de réforme est lancé, et ne s’arrêtera pas. De façon totalement imprévue, comme souvent dans l’Histoire, le mouvement va s’emballer, et un simple désir de « réformes » va se retrouver à provoquer rien de moins que l’éclatement confessionnel de l’Europe. Ainsi allait naître LA Réforme, un événement à la portée considérable, et qui marque un tournant décisif de l’Histoire du continent :
La Réforme protestante brisa l’unité et l’autorité de l’Église catholique, créant une pluralité dans le christianisme qui n’existait pas auparavant. Bien que des “hérésies” aient déjà remis en question l’autorité de l’Église, elles avaient été réprimées et la primauté de l’Église avait toujours été maintenue. Les concepts d’humanisme de la Renaissance, qui élevaient le statut de l’individu, ainsi que les technologies telles que l’imprimerie, associés à la corruption manifeste de l’Église médiévale, se combinèrent pour déclencher un mouvement qui allait transformer la pensée, la culture et la notion de “vérité” en Europe. […] Vers 1500, la vérité spirituelle était comprise comme étant ce que l’Église disait être ; cent ans plus tard, la “vérité” était beaucoup plus difficile à définir car, comme l’Église le fit si bien remarquer au début de la Réforme, si toute personne capable de lire la Bible pouvait définir la “vérité”, alors il n’y avait plus de “vérité” ultime à définir. Cet aspect de la Réforme fut probablement le plus profond, car il mit en évidence le pouvoir de l’individu de déterminer sa propre vérité, que ce soit en religion ou dans tout autre domaine de la vie, et il marqua la transition entre les paradigmes de pensée médiévaux et ceux de l’ère moderne.
Joshua J. Mark, « Dix choses à savoir sur la Réforme protestante », article traduit par Babeth Étiève-Cartwright pour la World History Encyclopedia
* * *
La diffusion des idées de Luther puis de Calvin : Réforme(s) et naissance du protestantisme
Des temps nouveaux s’approchaient ; la tempête que chacun prévoyait fondit sur l’Église. Luther publia à Wittemberg ses quatre-vingt-quinze thèses, et le catholicisme n’eut pas seulement à défendre la condition de ses prêtres, il fallut qu’il combattît pour ses dogmes essentiels.
Bernard Lazare, L’Antisémitisme : Son histoire et ses causes, p. 141
Bien que l’événement soit toujours désigné comme la Réforme protestante, il s’agissait en fait d’une série de mouvements distincts qu’il serait plus précis d’appeller réformations. En Allemagne, où Martin Luther mena la cause, il y avait aussi Martin Bucer (1491-1551), qui n’était pas d’accord avec certains aspects de sa vision, et Andreas Karlstadt (1486-1541), qui avait ses propres idées sur le “vrai christianisme”, tout comme le réformateur allemand Thomas Müntzer (c. 1489-1525). En Suisse, Ulrich Zwingli (1484-1531) était en désaccord avec Luther sur la nature de l’Eucharistie, et Jean Calvin (1509-1564) avançait son propre programme qui différait de celui de Zwingli.
Joshua J. Mark, « Dix choses à savoir sur la Réforme protestante », article traduit par Babeth Étiève-Cartwright pour la World History Encyclopedia
Avril 1521, Allemagne, à la Cour de la Diète de Worms. L’assemblée a été solennellement réunie pour juger un certain Martin Luther, dont les thèses secouent depuis quatre années le monde chrétien germanique. C’est le nouvel empereur d’Allemagne, Charles Quint, qui l’a convoqué pour défendre ses opinions devant la Diète (c’est-à-dire le Parlement du Saint-Empire romain germanique), muni d’un sauf conduit. Les amis de Luther, lui rappelant le sort de Jean Hus, condamné au bûcher par le concile de Constance en 1415, ont bien tenté de le dissuader de s’y rendre, mais Martin Luther leur a répondu : « Quand il y aurait à Worms autant de diables qu’il y a de tuiles sur les toits, j’y entrerais ». Le moine rebelle s’est donc mis en route vers Worms (il a même composé, durant ce voyage, les paroles et la musique du cantique qui deviendra ultérieurement célèbre sous le nom de « chorale de Luther »).
Le 17 avril 1521, les membres de la Diète demandent donc à Luther de se rétracter. Celui-ci leur répond qu’il le fera si l’on est capable de lui démontrer que ses critiques sont contraires à l’Écriture Sainte (c’est-à-dire à la Bible). Le moine allemand se serait alors écrié d’une voix humble mais ferme : « À moins d’être convaincu par le témoignage de l’Écriture, car je ne crois ni à l’infaillibilité du pape, ni à celle des conciles, je suis lié par les textes bibliques et ma conscience est prisonnière de la Parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n’est ni sûr ni honnête d’agir contre sa propre conscience. Que Dieu me soit en aide ! ».
Finalement, et contre toutes attentes, Luther sort libre de son procès face aux instances impériales. Néanmoins, il n’en est pas moins excommunié par le Pape, et mis au ban de l’Empire par Charles Quint. Les idées et les principes qu’il promeut, cependant, rencontrent un écho favorable chez de nombreux chrétiens du monde germanique, des simples fidèles aux princes d’Empire. Ayant trouvé refuge dans le château de Frédéric de Saxe, Luther se consacre pendant un an à traduire le Nouveau Testament en allemand. Il s’emploie parallèlement à préciser ses idées, qui sont reprises avec intérêt et passion par d’autres penseurs et théologiens du monde chrétien. Ce que l’on appellera bientôt « La Réforme » se diffusent alors à tout le nord et l’est de l’Europe, de l’Autriche à la Scandinavie, et de la Pologne aux îles Britanniques (avec Ulrich Zwingli à Zurich, puis Martin Bucer à Strasbourg, et plus tard Jean Calvin à Paris et Genève).
En aparté : qui était vraiment Martin Luther, et de quoi sa pensée était-elle le nom ?
Par sa révolte en 1517 (95 thèses sur les indulgences), Luther (1483-1564) est entrainé dans une dynamique qui le mène à la rupture avec Rome, la papauté. Elle est consommée en 1521, à l’occasion de la diète de Worms, quand Luther refuse de se rétracter. Ses ouvrages théologiques rencontrent rapidement un immense succès en Allemagne, progressivement gagnée par la Réforme. Les idées luthériennes se répandent en Europe (France, Danemark, Norvège, Suède…) dès la fin des années 1520.
Jean-paul Chabrol et jacques Mauduy, Atlas des Camisards, p. 9
À l’origine d’une philosophie religieuse (et donc sociale et culturelle) qui allait changer l’Europe et le monde, Martin Luther demeure un personnage mystérieux et à plusieurs facettes, dont certaines assez méconnues. Originaire d’une famille paysanne de Thuringe (une région du nord de l’Allemagne actuelle), Martin était prédestiné à être paysan, comme son père. Enfant brillant, il suit toutefois des études dans les écoles ecclésiastiques et obtient un diplôme de maître en philosophie à 22 ans. C’est suite à une « apparition » qu’il décide ensuite de se faire moine et d’entrer dans les ordres, contre la volonté de son père.
Reconnu par ses pairs pour son intelligence, Luther n’en est pas moins objet d’une psychologie troublée, qui évoque ce que l’on qualifierait aujourd’hui de « trouble anxieux généralisé ». C’est un personnage extrêmement angoissé, pessimiste, fataliste, sujets aux crises d’angoisse, et qui craint énormément de « faire le mal ». Luther se démarque également de ses pairs catholiques par sa croyance dans l’idée de « prédestination », dont il est important de dire ici deux mots, tant ce concept sera au cœur d’une fraction influente de la philosophie protestante (puis plus tard de la pensée janséniste).
La prédestination consiste à penser que l’homme est prédestiné à être ce qu’il va être – bon ou mauvais. Selon ce raisonnement, et d’une certaine façon dès la naissance, tout est déjà joué. Peu importe ce que vous pourrez faire ou ne pas faire : vous avez la grâce divine, ou vous ne l’avez pas, et selon si vous l’avez ou pas, vous ferez le bien, ou vous ferez le mal. Dans ce schéma de pensée, ce ne sont donc pas les actes qui comptent, mais la foi. Si vous avez foi d’être bon, alors vous ferez le bien via tous vos actes, peu importe ces derniers. Idem pour le mal.
À l’époque de Luther, comme nous l’avons développé plus haut, les « bonnes œuvres » (et toutes les dérives qui accompagnent cette tendance, comme le commerce des indulgences) ont pris une importance considérable dans la foi catholique. L’idée est ainsi de racheter les pêchés et de sauver les âmes du purgatoire par les dévotions, c’est-à-dire par les actes – actes de pénitence, actes de piété, actes de charité, etc. Luther se démarque donc au sein de ses contemporains catholiques par une toute autre conception du salut et de la grâce. Le prêtre allemand ne pense pas en effet que Dieu accorde sa grâce à tout le monde (il pense par exemple que les païens ne peuvent fondamentalement pas bénéficier de la grâce divine). De façon plus générale, Luther se caractérise par une vision très pessimiste et manichéenne de l’Homme. À l’opposé de la pensée humaniste qui connaît un essor considérable à l’époque (puis plus tard de philosophes comme Rousseau), il ne pense pas que l’Homme soit fondamentalement bon. Certains historiens vont même jusqu’à l’analyser comme un individu profondément misanthrope.


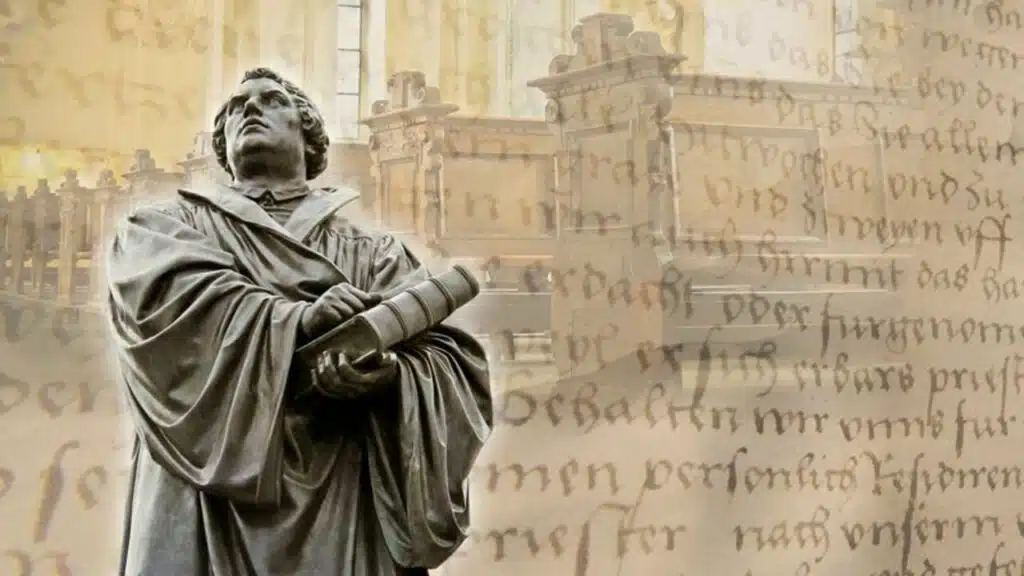

La position que Luther a développé vis-à-vis de la question de la grâce et de la foi l’amène à se poser en fervent critique de la pratique des indulgences, qui est alors également critiquée par d’autres de ses contemporains. Le jour où un célèbre moine dominicain promoteur de cette pratique est de passage à Wittemberg, Luther profite ainsi de l’occasion pour afficher ses critiques et ses propositions de réforme sur le portail de l’église. Dans ses thèses, il affiche notamment son idée de la prédestination, qui s’oppose alors frontalement à la doctrine chrétienne de l’époque (selon les canons catholiques, Dieu peut en effet accorder sa grâce à tout le monde, et tout pêché peut être racheté par les « œuvres », ainsi que le salut de l’âme).
Le « coup politique » de Luther va avoir (sans que cela ait été probablement son intention) une portée sociale considérable, notamment au sein de la paysannerie. Durant les années 1524-1525 (c’est-à-dire quelques années après la parution puis diffusion des idées de Luther), des révoltes paysannes de grande ampleur secouent l’Allemagne. Les paysans réclament la diminution voire la suppression des privilèges féodaux, notamment des impôts aux seigneurs et à l’Église (dîme), et souhaitent récupérer tout ou partie des communaux (terres collectives gérées directement par les communautés villageoises) qu’ils ont perdu au cours des derniers siècles. Selon certains historiens, les idées luthériennes ont étroitement été à la racine de ces révoltes, par la remise en cause qu’elles ont portée de l’autorité papale et ecclésiastique (et donc par extension de l’Autorité tout court). Il est important également de rappeler qu’en ce début de XVIe siècle, l’Europe est lourdement impacté par les conséquences économiques et sociales de la découverte du Nouveau Monde. L’afflux des métaux précieux en provenance des Amériques a en effet entraîné une forte augmentation du numéraire en circulation sur le Vieux Continent, qui a elle-même entraîné une forte inflation. Ce renchérissement des prix des produits du quotidien conduit en corollaire de nombreux seigneurs à augmenter leurs redevances, ce qui a pour effet de majorer encore davantage la contraction du pouvoir d’achat que subit la classe paysanne (qui représente alors jusqu’à 90% de la population de certaines régions). C’est cette dégradation de grande ampleur des conditions de vie matérielles des Européens, couplée aux idées luthériennes de remise en cause de l’autorité sur le plan pratique, qui sera à la racine des révoltes des années 1524-1525 en Allemagne :
Excédés de misères, décimés par la guerre, ruinés, réduits à l’esclavage, en proie au dénuement et à la famine, les paysans du seizième siècle ne s’en prirent plus uniquement au Juif prêteur d’argent ou au chrétien usurier, ils visèrent plus haut, ils attaquèrent d’abord toute une classe, celle des riches, et ensuite l’état social tout entier. Leur révolte fut générale, ce furent d’abord les paysans des Pays-Bas, ensuite, et surtout, ceux de l’Allemagne. Dans tout l’empire ils avaient fondé des sociétés secrètes, le Bundschuh, le Pauvre Conrad, la Confédération évangélique. En 1503 les paysans de Spire et des bords du Rhin s’insurgèrent ; en 1512 les bandes de Joss Fritz ; en 1514 les paysans du Wurtemberg ; en 1515 les paysans d’Autriche et de Hongrie ; en 1524 ceux de Souabe ; en 1525 ceux de Souabe, d’Alsace, du Palatinat. Tous marchèrent au cri de « En Christ il n’y a plus ni maître ni esclave ». Les artisans se joignirent à eux, des chevaliers comme Goetz de Berlichingen se mirent à leurs têtes et ils massacrèrent les nobles et incendièrent les châteaux et les couvents.
Bernard Lazare, L’Antisémitisme : son histoire et ses causes, p. 139
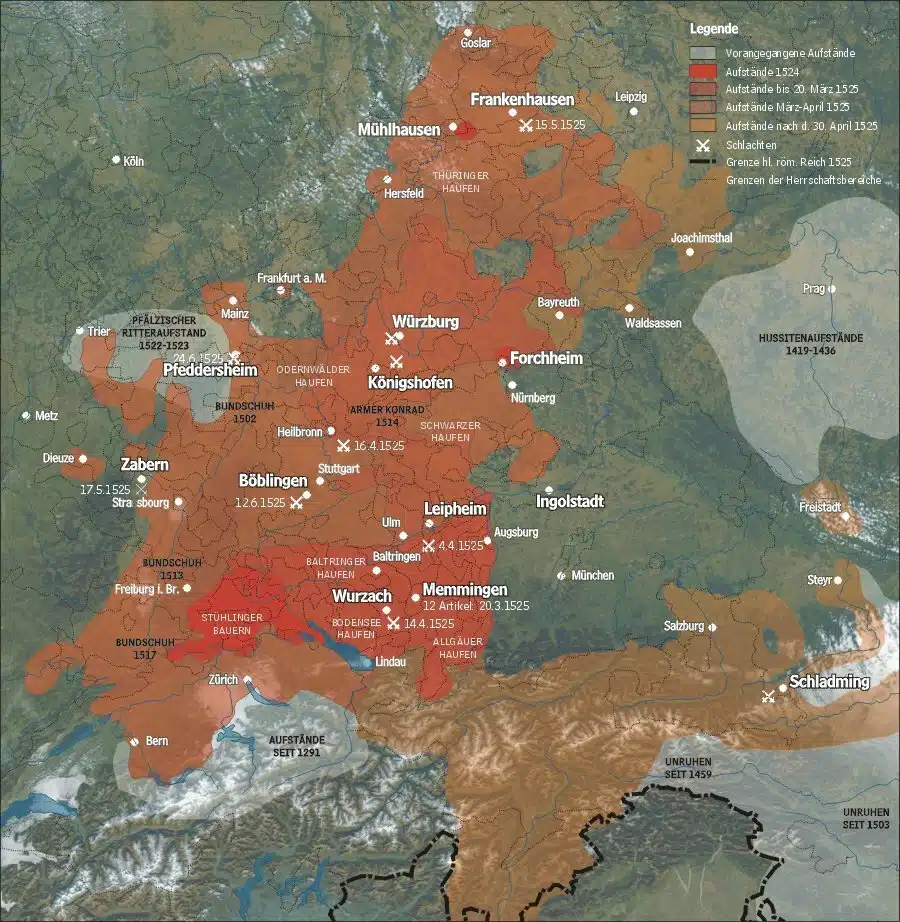
Loin de soutenir les revendications des paysans qui se nourrissent en partie de ses idées, Luther va au contraire violemment condamner les révoltes, et même appeler à une répression féroce de ces dernières. Dans le pamphlet qu’il publie en 1525 en réaction aux soulèvements, le théologien allemand va en effet jusqu’à comparer les révoltés à des « hordes sataniques », tout en incitant ni plus ni moins les seigneurs aux massacres pour éteindre le soulèvement :
(…) tous ceux qui le peuvent doivent assommer, égorger et passer au fil de l’épée, secrètement ou en public, en sachant qu’il n’est rien de plus venimeux, de plus nuisible, de plus diabolique qu’un rebelle (…). Ici, c’est le temps du glaive et de la colère, et non le temps de la clémence. Aussi l’autorité doit-elle foncer hardiment et frapper en toute bonne conscience, frapper aussi longtemps que la révolte aura un souffle de vie. (…) C’est pourquoi, chers seigneurs, (…) poignardez, pourfendez, égorgez à qui mieux mieux.
Extrait du texte Contre les meurtriers et les hordes de paysans voleurs publié par Luther en 1525
Au final, la répression de ces soulèvements populaires (entrés dans l’Histoire sous le nom de « Guerre des paysans allemands ») fera plus de 100 000 morts. Par sa violence et ses dimensions de guerre civile, cette révolte de grande envergure préfigurera la terrible guerre de Trente Ans, conflit autant religieux que social qui déchirera durant trois décennies l’ensemble du Saint-Empire romain germanique (et qui décimera jusqu’à 60% de la population de certaines régions d’Europe centrale). Martin Luther, de son côté – et malgré son engagement monastique –, se mariera et aura plusieurs enfants. Il mourra à 62 ans à Eisleben, sa ville natale.
En proposant toutefois une autre manière de vivre sa foi chrétienne (établie cette fois uniquement sur la Bible, dont l’Écriture devient la seule autorité), en dénonçant les œuvres méritoires et les indulgences, et mettant en avant le principe biblique de la grâce seule par la foi seule (Sola scriptura, sola gratia, sola fide), le luthéranisme répond aux aspirations et aux attentes de nombreux Allemands. À partir de 1529, on les désigne désormais sous le nom de « protestants ». Ce premier protestantisme se répand rapidement dans les pays scandinaves (Danemark, Suède, Norvège, Islande,…). La « Réformation » touche également l’Angleterre avec Henry VIII, en rupture avec la Papauté à partir de 1533. C’est la naissance de ce qu’on appellera plus tard l’anglicanisme, religion qui conserve des rites catholiques tout en étant substantiellement influencée par le calvinisme (dont nous allons bientôt parler). Les protestants écossais sont, quant à eux, très majoritairement devenus calvinistes (presbytériens).

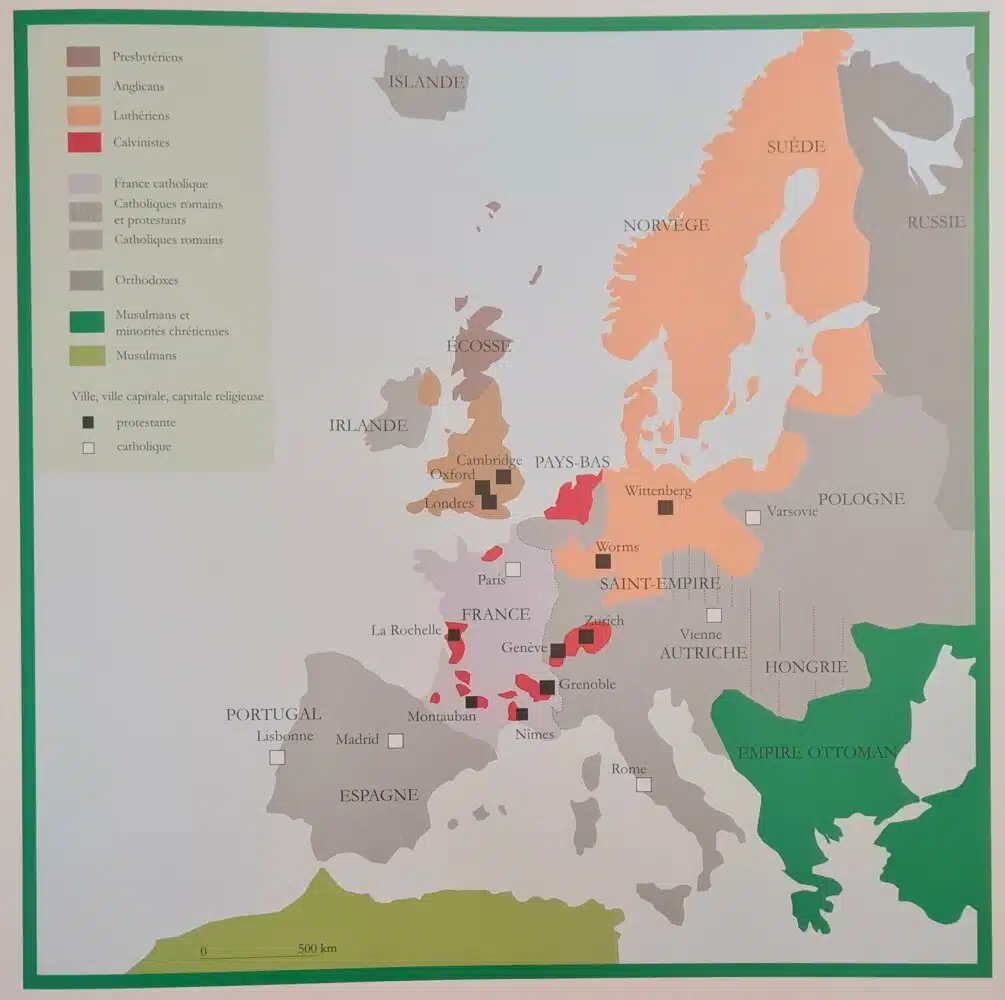
Contre les consignes du Saint-Siège, les princes allemands (sauf la Bavière), les princes des Provinces-Unies (Hollande), les villes suisses, les souverains et princes du nord de l’Europe puis l’Écosse, le Pays-de-Galles et l’Angleterre vont protéger et soutenir les réformateurs. L’Église catholique ne pourra ce faisant pas, pour ainsi dire, « mettre la main dessus et les donner au bras séculier pour les brûler ». Bientôt, les guerres de Religion vont commencer. Elles vont ensanglanter les pays d’Europe durant près de deux siècles. Catholiques et protestants vont se livrer, partout, des guerres sans merci.
Zoom sur : la Réforme anglaise et la naissance de l’anglicanisme
Tout le monde ou presque connaît l’histoire du roi Henri VIII qui va créer son Église afin de pouvoir divorcer de sa femme. La fondation de l’Église anglicane qui en résulte (sorte de compromis mouvant entre catholicisme et protestantisme) mérite néanmoins que l’on s’y intéresse, car au-delà de sa simplicité apparente – « une Église pour un divorce » –, celle-ci porte en elle des motifs beaucoup plus profonds, inhérents à l’évolution des réalités sociopolitiques de l’époque, et où les considérations religieuses vont se retrouver ainsi mêlées très étroitement à l’agenda politique (à la fois personnel et stratégique) de son souverain, donnant ce faisant à la Réforme anglaise un caractère singulier pour ne pas dire absolument unique à l’échelle de l’Histoire (du protestantisme et du monde) !

Le schisme en Angleterre survient donc lorsque le célèbre Henri VIII (1491-1547), roi d’Angleterre et d’Irlande de 1509 à sa mort, a besoin de divorcer de sa femme légitime (Catherine d’Aragon) afin d’épouser sa favorite Anne Boleyn et ce faisant d’avoir un héritier mâle – divorce que lui refuse le Pape. Soit ! Si l’Église catholique l’interdit de divorce, pourquoi ne pas créer tout simplement sa propre Église qui, elle, le lui autoriserait (plus quelques autres avantages au passage, tant qu’à faire) ? Il suffisait peut-être effectivement d’y penser : par l’Acte de Suprématie (ainsi que toute une série de législations coordonnée par son conseiller en chef Thomas Cromwell – l’ancêtre du célèbre puritain révolutionnaire du XVIIe siècle !), Henri VIII fonde ainsi en 1534 sa propre Église : l’Église d’Angleterre, dont il devient le chef spirituel. Le principe est simple : l’Église d’Angleterre devient Église d’État, et l’anglicanisme devient en corollaire religion d’État. En d’autres termes, l’Angleterre aura désormais la religion de son souverain, celui-ci devenant désormais l’autorité suprême du Royaume et de son Église, et ces deux derniers (qui forment désormais un tout indissociable) ne reconnaissent plus aucune autorité supérieure (comme auparavant celle du Pape), hormis celle de Dieu lui-même.
Tout ceci étant dit, il faut se garder d’interpréter cette rupture avec Rome et la fondation de sa propre Église de la part d’Henri VIII comme un rejet en bloc du catholicisme en faveur du protestantisme (en tout cas à ce stade de l’Histoire). Attaché aux traditions catholiques – et à la différence des idées luthériennes et surtout calvinistes –, ce n’est pas le système de croyances et le corpus théologique de l’Église romaine que le souverain anglais remet en cause, mais précisément sa qualité Ès romaine ! Dans sa première phase au moins (car effectivement il évoluera beaucoup entre le règne d’Henri VIII et celui de la reine Élisabeth), l’anglicanisme doit ainsi d’abord se voir comme un instrument de souveraineté et d’affirmation de la puissance de l’État ainsi que comme le produit de l’émergence d’un sentiment national – deux processus caractéristiques de ce début de XVIe siècle marqué en Angleterre comme en France par la centralisation du pouvoir monarchique tant vis-à-vis du “bas” (les seigneurs et les anciens pouvoirs féodaux) que du “haut” (la Papauté).
En fait, vue d’une certaine façon, la Réforme anglaise et la doctrine anglicane constituent peut-être le mouvement le plus fidèle à la philosophie initiale de la Réforme, en ce sens qu’elles ne consistent pas en une scission complète sur le plan de la doctrine et des pratiques d’avec le catholicisme, mais plutôt en une adaptation de celui-ci aux nouvelles réalités politiques du XVIe siècle (marquées par l’émergence des États modernes et la montée en puissance des pouvoirs centraux aux dépends des systèmes féodaux). Bien sûr, la Réforme anglaise adoptera un certain nombre de principes « réformés » faisant écho aux nombreux griefs que l’Église catholique avaient accumulés contre elle (concentration du pouvoir, corruption,…), tels que la rupture avec l’autorité centrale que constitue la Papauté mais aussi la fin du culte jugé ostentatoire des reliques ou encore la démocratisation de la lecture de la Bible et la tenue des messes en anglais (et non plus en latin !). Dans les faits, l’anglicanisme doit donc d’abord se concevoir comme une sorte de compromis entre catholicisme et protestantisme (voire dans sa première phase historique comme un « catholicisme réformé » – qui avec le temps va prendre une coloration de plus en plus « protestante »). Ayant fait sienne certains grands principes « réformés », l’Église d’Angleterre va ainsi dans un premier temps conserver sous Henri VIII une bonne partie de l’organisation catholique (notamment un certain nombre de rites liturgiques ainsi que tout le système des évêques – désormais affiliés à l’Église d’Angleterre et nommés par le monarque et non plus par le Pape !), et il faudra attendre ses successeurs (en particulier Édouard VI et Élisabeth Ire après un éphémère retour au catholicisme sous Marie Stuart) pour la voir évoluer vers un protestantisme plus affirmé !
Bon nombre des sujets d’Henri étaient soit indifférents à ces changements, soit désireux de voir l’Église se réformer et de poursuivre ainsi le mouvement de la Réforme protestante qui balayait l’Europe. Beaucoup considéraient l’Église comme trop riche et trop pleine de prêtres abusant de leur position. D’autres s’en remirent simplement à l’opinion de leurs supérieurs sociaux et ne se soucient guère de ce qui se disait et se faisait à l’église, du moment qu’une sorte de service était disponible. […] La majorité des gens acceptèrent le changement, les riches en raison de la richesse qu’ils tirèrent de l’Église dépouillée, et les roturiers parce qu’ils s’en remettaient aux autorités et se voyaient imposer des amendes s’ils ne respectaient pas les règles et ne fréquentaient pas la nouvelle Église anglicane, comme on l’appelait désormais. Il y eut cependant des objections de la part des catholiques et des protestants plus radicaux tels que les différents groupes puritains qui voulaient suivre leur propre voie et établir leurs propres églises qui adhéraient plus étroitement aux pensées exposées par des réformateurs tels que Jean Calvin (1509-1564).
Extrait d’un article de l’historien mark cartwright pour la World History Encyclopedia

Beaucoup plus méconnu et déterminant historiquement à vrai dire qu’une Réforme anglaise conduite en définitive par son roi dans le but tout simple de pouvoir s’accorder son propre divorce (et plus fondamental de renforcer son autorité), est en revanche l’épisode de la dissolution des monastères qui va intervenir durant les années suivantes. Suite aux guerres contre la France dans lesquelles l’Angleterre s’est engagée dans les années 1520, le budget de l’État en a été grandement impacté, et Henri VIII a désespérément besoin d’argent fais pour assurer son train de Cour. Il faut ce faisant au souverain anglais de nouvelles recettes fiscales – beaucoup, et vite ! – afin d’éviter la banqueroute, mais aussi de financer l’ambitieuse marine de guerre dont il entend doter le pays (c’est en effet sous son règne que l’Angleterre entame son grand virage maritime et développe sa puissance navale en se dotant pour la première fois d’une marine permanente, la Royal Navy – dont Henri VIII est d’ailleurs souvent considéré comme le père fondateur). Où donc trouver l’argent ? Dans le contexte de rupture avec le catholicisme et son Église, la cible apparaît à vrai dire toute trouvée : il y a tous ces monastères qui garnissent les campagnes anglaises, et qui ne payent virtuellement pas d’impôts à l’État…
À l’instar de nombreuses régions d’Europe, le territoire anglais abrite en effet plusieurs centaines d’abbayes de plus ou moins grosses tailles, héritage de la grande époque du « communisme sacerdotal » et du « système communaliste chrétien » développés au milieu du Moyen-Âge par le mouvement bénédictin puis l’ordre cistercien. Si celles-ci sont pour nombre d’entre elles sur le déclin, elles n’en jouent pas moins un rôle fondamental dans le quotidien des populations de l’époque (alors essentiellement rurales et paysannes). En ce début de XVIe siècle, les abbayes constituent toujours et dans l’ensemble du pays l’une des institutions de base de la vie locale, dont elle organise la spiritualité, assure la charité et soutienne l’économie (partout où ils sont installés, les moines distribuent en effet des aumônes et d’autres œuvres de charité au profit des pauvres, des chômeurs et des veuves ; ils éduquent les jeunes enfants pauvres et les enfants plus âgés des riches ; ils dispensent des médicaments ; ils donnent du travail aux ouvriers pour exploiter leurs domaines tout en constituant des clients précieux pour les artisans du village ; ils offrent l’hospitalité aux pèlerins, aux voyageurs et aux travailleurs saisonniers – sans même parler de tout leur rôle d’ordre religieux et spirituel !).
Malgré ce rôle social et économique décisif pour le quotidien des Anglais, les monastères se retrouvent en cette fin des années 1530 dans le collimateur d’Henri VIII et de ses conseillers : après une vaste enquête de terrain, ces derniers ont en effet constaté que les immenses revenus générés par l’activité monastique échappaient aux circuits de la fiscalité anglaise, tandis que les monastères représentent près du cinquième des terres cultivées du pays. Le raisonnement est en fait le même que celui qui présidera à la confiscation des biens de l’Église durant la Révolution française (comme nous le constatons encore une fois, l’Angleterre aura été pionnière… !) : sous couvert de motifs religieux et d’ordre public (les moines et nonnes anglaises seront en effet accusés de tous les maux), il s’agit en premier lieu de mettre la main sur le formidable « butin » que représente le patrimoine ecclésiastique …
À l’instar à nouveau de la Révolution française, le processus va être d’une grande violence. Les premiers établissements auxquels Henri VIII va s’attaquer vont être les petites unités monastiques, en perte de vitesse et qui manquent souvent de bras pour assurer leur fonctionnement. En quelques-années, ceux-ci vont être intégralement fermés, leurs terres expropriées par l’État, leurs bâtiments partiellement ou entièrement démolis (les vastes quantités de terres ainsi confisquées seront revendues au fur et à mesure par Henri VIII à la petite noblesse et bourgeoisie de province – ce qui permettra au roi de clientiser ces dernières par la même occasion !). Cette première vague d’expropriation permet de renflouer substantiellement les caisses de l’État, mais Henri VIII et ses conseillers ne s’arrêtent pas là : bientôt, ce sont tous les monastères d’Angleterre qui sont concernés par la dissolution.
La réforme ne se fait évidemment pas sans heurts : dans le Yorkshire et le Lincolnshire (où les établissements sont nombreux), une révolte populaire se dresse contre la politique de fermeture, faisant un moment vaciller le pouvoir royal. Henri VIII envoie 8 000 hommes disperser la contestation à laquelle il consent d’importants compromis, avant de profiter quelques temps plus tard d’une nouvelle révolte (sans rapport avec la première…) pour faire exécuter les meneurs. Opposés quasiment partout à la réforme malgré les généreuses pensions qui leur sont offertes pour acheter leur consentement, de nombreux abbés du pays finissent pendus, et les communautés monastiques sont mises au chômage. Durant les années qui suivront, la criminalité augmentera considérablement dans les campagnes, de nombreuses familles modestes se voyant également chassées de leurs terres par le processus parallèle de l’enclosure (le rachat puis la disparition des « communaux » paysans – c’est-à-dire des terres collectives – par les riches propriétaires terriens anglais, qui les transforment en zone de pâturage extensif – d’où le nom d’enclosure se rapportant aux kilomètres de murets de pierre qui sont construits pour délimiter les terrains – destiné à l’élevage de moutons).
Henri VIII augmenta effectivement les coffres de l’État, puisque la dissolution des monastères rapporta la somme énorme de 1,3 million de livres (plus de 500 millions aujourd’hui), bien que la plupart des terres aient été vendues à bas prix à des nobles et que l’argent ait été largement gaspillé dans des guerres étrangères ou dépensé dans les nombreux projets de construction royale d’Henri. Environ 7 000 moines, frères, nonnes et autres résidents des monastères furent obligés de trouver un autre travail et un autre logement, tandis que le coup porté au moral de l’Église était incommensurable – bien que tangible par la forte réduction du nombre de ceux qui cherchaient désormais à faire carrière dans l’Église. En l’absence des abbés, la Chambre des Lords fut dominée par des laïcs. Les trésors furent fondus, les toitures dépouillées de leur plomb et les bibliothèques mises à sac. Le vieux monde médiéval perdit un grand nombre d’objets d’art et d’artefacts, au grand dam de la postérité. Il ne fait aucun doute que les communautés durent regretter le travail de charité, l’emploi et l’aide spirituelle de leur monastère local. Certains historiens ont suggéré que le manque d’aumônes pour les pauvres entraîna une augmentation du nombre de vagabonds, ce qui conduisit à une augmentation de la criminalité et de l’instabilité sociale.
Extrait d’un article de l’historien mark cartwright pour la World History Encyclopedia



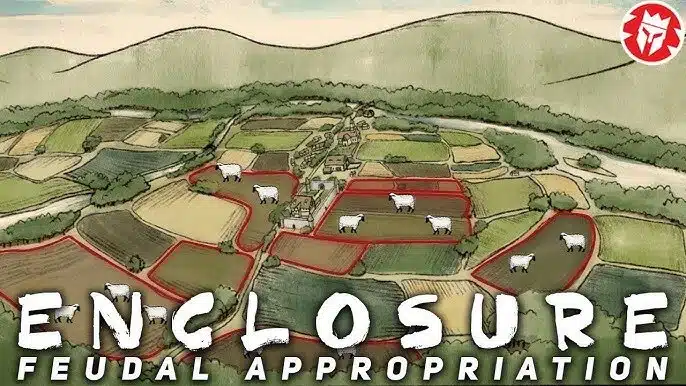






* * *
EN RÉSUMÉ, l’Église anglicane se situe ainsi quelque part à la croisée de la doctrine de l’Église catholique et de celle des Réformés. Elle fait (à partir du règne d’Élisabeth Ire) totalement siens les grands principes de la Réforme (avec notamment l’adoption en 1646 de la confession de foi de Westminster), mais garde – en particulier dans sa liturgie (c’est-à-dire dans ses rites, cérémonies et prières) – une influence catholique. Le culte reste imposant et l’on garde les évêques. Le roi (ou la reine) est désormais érigé au rang de chef de l’Église d’Angleterre (devenue Église d’État), et l’anglicanisme devient en corollaire religion d’État.
La pensée de Calvin et la diffusion de la Réforme à la France
La Réforme prend un nouvel essor avec Jean Calvin (1509-1564), dont l’œuvre majeure, L’Institution de la religion chrétienne, est publiée en 1536. De Genève, où il s’installe définitivement en 1541, les idées calvinistes se diffusent à leur tour en Europe et notamment en France. « Dressées » sur le modèle genevois, les églises se multiplient dans le royaume et plus particulièrement dans l’Ouest et le Midi.
Jean-paul Chabrol et jacques Mauduy, Atlas des Camisards, p. 9
Les idées luthériennes pénètrent tôt en France, où elles rencontrent les aspirations réformatrices de nombreux Français. Mais la « Réformation » hexagonale va surtout se développer sous l’effet de la pensée du français Calvin, dont les idées se diffusent en Europe à partir de 1534.

Né en Picardie et ayant fait ses études à l’Université d’Orléans, Jean Calvin adopte dès le début des années 1530 les nouvelles idées de la Réforme protestante. Devenu pasteur et accusé d’hérésie en raison de ses liaisons étroites avec d’autres prédicateurs influents du moment, il fuit à Bâle. Là, influencé par Luther, Melanchthon, Oecolampade, Zwingli et Bucer, il rédige et publie en 1536 l’Institution Chrétienne, traité de théologie et texte fondateur du protestantisme qui s’apparente à la synthèse de la doctrine réformée. Dans la continuité de Luther, et contre ceux qui défendent le mérite des œuvres et le purgatoire (voire qui « payaient » pour être pardonnés), Calvin y reprend et parachève la conception luthérienne du salut : celle du salut gratuit par la foi et par la foi seule.
L’ouvrage rencontre un franc succès et Calvin, maintenant installé à Genève (qu’il organise en une Église-cité originale dont le modèle est bientôt copié en France et dans d’autres parties de l’Europe), s’emploie à organiser les communautés réformées de langue française. En vertu du grand principe réformé voulant en revenir à la seule Écriture et à la rendre accessible à tous, il supervise la traduction de la Bible en français à partir des textes originaux (démarche réalisée notamment par Robert Ollivier, dit Olivétan).
Zoom sur : au centre des débats théologiques, la question du salut
Vous l’avez compris, la question du salut est un des points sensibles sur lequel se fait la Réforme, puis sur laquelle se divisent ensuite les protestants – luthériens ou calvinistes.
Pour les catholiques : le salut par les œuvres
Comme nous l’avons évoqué plus haut, la théologie catholique met l’accent sur la liberté de l’individu (libre arbitre). Une fois baptisé (le baptême permettant d’effacer la faute originelle, le péché d’Ève), le chrétien peut, par l’accomplissement d’actes justes (les fameuses « œuvres »), ou par un repentir sincère des fautes qu’il a commises, mériter son salut.
Pour les luthériens : le salut par la foi
Luther, à l’inverse, insiste (via son célèbre « Traité du serf arbitre ») sur l’impuissance de l’homme à effectuer lui-même son salut. Marqué définitivement par la faute originelle, il ne peut que pécher, non accomplir des actes justes. Ce ne sont donc pas les œuvres qui permettent au chrétien d’accomplir son salut, mais la parfaite confiance qu’il a en la bonté divine : sa foi en Dieu. Encore cette foi ne procède-t-elle pas d’un libre choix de l’homme : elle est accordée seulement à certains hommes, par grâce divine (c’est la fameuse doctrine dite de la « prédestination », qui constitue déjà à ce titre l’un des marqueurs du judaïsme).
Pour Calvin : le concept de la « double prédestination »
Calvin reprend le concept de prédestination de Luther et va encore plus loin. Dans ses traités, le théologien français réduit en effet encore la part de l’action humaine dans le salut. Pour lui, Dieu a choisi des élus avant la chute, et son Fils Jésus, par sa Passion, n’a sauvé que ces élus. Les hommes sont donc deux fois prédestinés, soit à être sauvés, soit à être damnés. Ceux que Dieu a choisi de sauver, ceux auxquels il a accordé sa grâce ne peuvent pas résister à cette grâce : si grands soient les péchés qu’ils accomplissent, ils seront sauvés pour l’éternité. Une vision qui a aussi pour propriété, comme nous en reparlerons plus loin, de justifier tous les actes réalisés dans le monde matériel par ceux qui se croient ainsi « touchés par la grâce » …
Le protestantisme – qu’il s’agisse de celui de Luther ou de celui de Calvin – substitue la théologie des actes à la théologie de la grâce.
Youssef Hindi, dans le cadre d’une conférence publiée sur sa chaîne
Parallèlement à leur concentration sur la Bible et « l’Écriture Sainte », les protestants se démarquent rapidement partout en Europe par leur refus du culte des saints et des idoles. Les chrétiens réformés le sont effectivement devenus parce qu’ils étaient scandalisés par les dépenses somptuaires des princes de l’Église, et par les riches dorures et ornements qui caractérisaient les églises et statuaires catholiques. Ils veulent ainsi retrouver la simplicité et la pauvreté du Christ et des premiers apôtres, et se comporter à l’image notamment de Saint-François d’Assise (qui œuvrait lui aussi retrouver une certaine pauvreté). Le nouveau culte protestant se dépouille en conséquence de tout décorum inutile. Le Temple protestant est à cet égard d’une sobriété absolue. Il consiste généralement en une Église à l’architecture et surtout à la décoration extrêmement réduite, s’apparentant à une pièce vide avec une Bible en évidence, une simple croix de bois et un promontoire pour que le pasteur fasse son sermon. On détruit les statues, les reliques. Le Traité des reliques de Calvin est d’ailleurs d’un humour féroce sur cette forme particulière de dévotion. Le grand théologien de la Réforme va ainsi jusqu’à compter le nombre de crânes et d’ossements de saints existants de par le monde, ainsi que les innombrables « morceaux de la vraie Croix » du Christ recensés dans la Chrétienté.

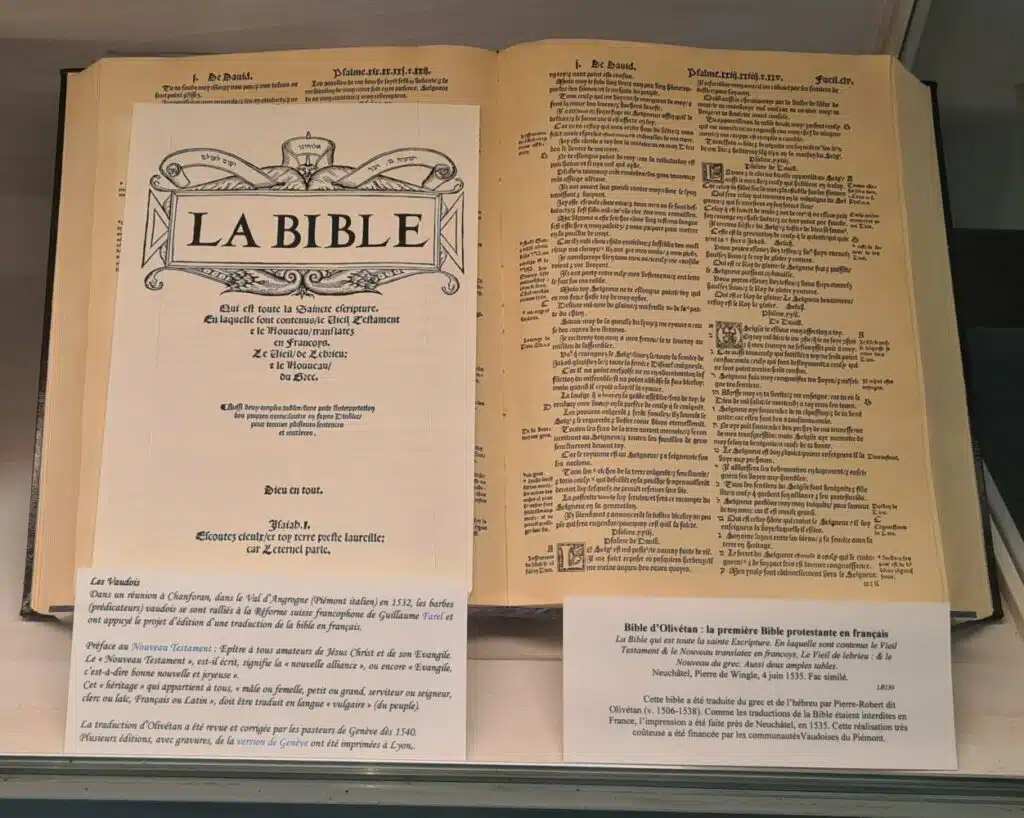

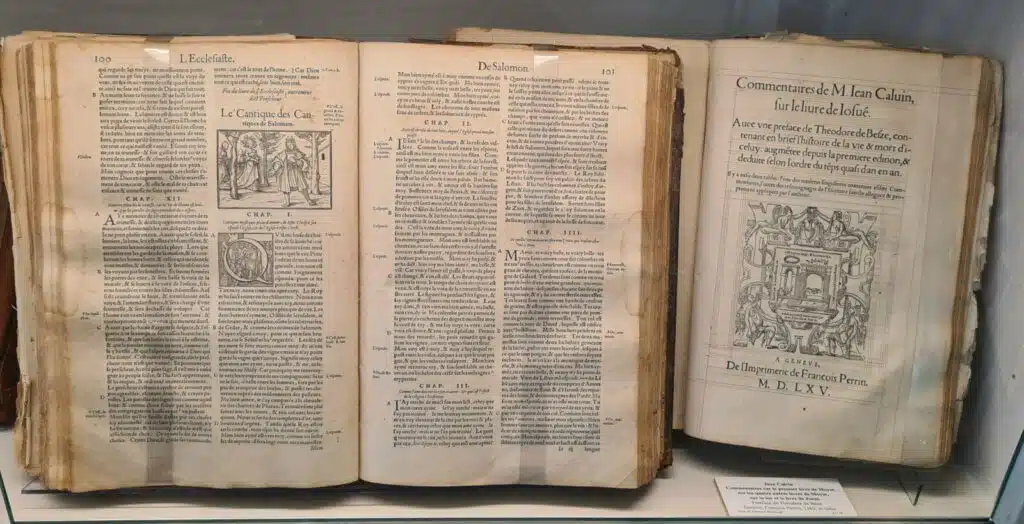
Loin des fastes et de l’ostentation qui caractérisent ainsi le culte catholique dans la plupart des pays, le culte protestant se concentre donc sur l’étude de la Bible et s’organise en conséquence autour du sermon du pasteur – où la lecture de la Bible et son commentaire deviennent obligatoires. Les protestants (et particulièrement les protestants calvinistes) sont, à ce titre, souvent qualifiés d’austères par leurs contemporains. Ils sont connus pour s’habiller en noir et pauvrement, et pour renier les différents « plaisirs » de la vie. En effet, les calvinistes suppriment le jeu, sont très sobres et réticents à écouter de la musique profane – à l’exception des psaumes chantés en chœur lors du culte dominical (à l’occasion de leur arrivée au pouvoir en Angleterre durant l’épisode de la République cromwellienne, les Puritains anglais feront ainsi par exemple fermer les théâtres et interdire les festivités de Noël…).
* * *
La foi protestante : une piété qui ignore le rituel
Le mouvement Humaniste, en prônant le retour à la lecture des textes anciens, actualise l’exigence de la soumission du chrétien à la seule parole de Dieu. « Sola scriptura », proclament les réformateurs qui demandent avec force que la Bible représente désormais l’unique vecteur de la Parole de Dieu. Une refondation culturelle et religieuse de la société est ainsi engagée.
Révolté par la campagne des « Indulgences », Luther affirme en 1517 une idée en rupture, à savoir que le croyant ne sera pas sauvé par ses œuvres mais par grâce, par le seul moyen de la foi dans l’œuvre du Christ. À cette idée du salut gratuit, le prêtre allemand joint celles de l’autorité souveraine de la Bible et du sacerdoce universel, qui place clercs et laïcs au même plan et abolit donc le principe hiérarchisé de l’Église romaine. La relation à Dieu devient ainsi directe et individuelle. Ses convictions se diffusent en Europe en dépit de la persécution.
La Réforme se positionne donc fondamentalement en réaction des turpitudes de l’Église. Elle se construit autour de quelques principes simples résumés par ces cinq expressions latines : Sola gracia (la Grâce seule), sola fide (la Foi seule), sola scriptura (l’écriture – c’est-à-dire la Bible – seule), soli Deo gloria (À Dieu seul la Gloire), solus Christus (le Christ seul). En conséquence, la piété réformée va se détourner avec force du rituel qui a cours dans la religion catholique romaine. Être réformé, c’est en effet refuser des pratiques qui semblent idolâtres et paraissent irréconciliables avec le culte réformé « en esprit et en vérité ». Le protestantisme refuse ainsi :
- Le « mystère » de la messe c’est-à-dire le sacrifice du Christ symboliquement opéré par le prêtre quotidiennement ;
- L’Eucharistie et la théorie de la transsubstantiation par laquelle le pain et le vin sont réellement convertis en corps et sang du Christ après la consécration ;
- Les signes de croix, les processions, les génuflexions, le culte des reliques, le culte marial, celui des saints et des images pieuses ;
- Le purgatoire et l’autorité papale.
En s’écartant ainsi d’un cérémonial perçu comme entaché de superstitions, le protestantisme va permettre à chacun de pratiquer sa religion dans un espace d’intimité, au sein de la famille ou sur le lieu de ses activités quotidiennes. Sur les sept sacrements reconnus dans la tradition catholique, l’homme réformé ne va en pratique en conserver que deux : le baptême, et la sainte cène (c’est-à-dire le partage du pain et du vin entre les participants lors d’un office). Le culte marial, extrêmement présent dans le catholicisme, est quant à lui totalement banni de la foi réformée, qui ne reconnaît pas la Vierge Marie comme la mère biologique de Jésus et rejette son rôle d’intercesseur auprès du Christ (pourtant centrale dans la piété chrétienne).
Les protestants ont éliminé du christianisme toute trace de paganisme, alors que le catholicisme les a assimilées : culte des saints, de la Vierge, et les nombreuses fêtes du calendrier…
« La chasse aux sorcières, prêtresses d’Artémis : extermination du paganisme matriarcal par l’Église », extrait d’un article paru sur le site web du mouvement matricien
De façon générale, mis en perspective avec le catholicisme, le protestantisme (et en particulier le calvinisme) s’apparente à un culte extrêmement réduit, épuré de quasiment tout ce qui constituait la tradition catholique. Les protestants rejettent peu ou prou toutes les pratiques traditionnelles autour desquelles s’était fondé le catholicisme du quotidien (et avec lui, l’environnement matériel des pays catholiques) : l’eucharistie (avec l’hostie partagé à chaque messe et incarnant le corps du Christ), la piété envers les reliques des Saints, les processions (manifestations populaires annuelles réunissant généralement des milliers de personnes !), l’extrême-onction donnée aux mourants, le culte de la Vierge Marie (qui se matérialise dans des pays catholiques comme la France par des milliers et des milliers de sanctuaires, chapelles, etc., présentes dans chaque parcelle du territoire, et objet d’une dévotion populaire extrêmement importante !). Il faut ainsi véritablement prendre la mesure de la rupture inédite que peut représenter pour les catholiques la diffusion de la foi protestante, avec l’apparition et la propagation d’un culte chrétien réduit à sa plus simple expression. En l’occurrence : un pasteur, une église (presque vide), et la Sainte-Bible.
L’influence du judaïsme sur le protestantisme
Les Juifs ne furent pas la cause de la Réforme, et il serait absurde de le soutenir, mais ils en furent les auxiliaires. Voilà ce qui doit séparer l’historien impartial de l’antisémite. L’antisémite dit : le Juif est le « préparateur, le machinateur, l’ingénieur en chef des révolutions » ; l’historien se borne à étudier la part que le Juif, étant donné son esprit, son caractère, la nature de sa philosophie et de sa religion, a pu prendre au procès et aux mouvements révolutionnaires.
Bernard Lazare, L’Antisémitisme : son histoire et ses causes, p. 335
Des contemporains ont d’ailleurs cru percevoir dans les nouveaux principes insufflés par le protestantisme l’influence du judaïsme, dont le clergé s’était toujours montré critique envers les rites et traditions catholiques (certains auteurs ont même été jusqu’à qualifier le protestantisme de « christianisme judaïsé » !). Dans un contexte où la critique des « dérives » de l’Église catholique et de son fonctionnement se révèlent de plus en plus prégnants, de nombreux savants, intellectuels et théologiens chrétiens de la Renaissance vont en effet se replonger dans les sources hébraïques du Christianisme, par l’étude de la Bible hébraïque (Ancien Testament) et des différentes écritures sacrées du judaïsme (notamment la littérature talmudique) – démarche permise et nourrie par l’essor de l’imprimerie, la diffusion des idées humanistes et l’intérêt général de ces dernières pour la période antique et ses grands penseurs. Cette diffusion de la théologie et de la philosophie judaïques au sein de l’élite intellectuelle chrétienne va avoir une influence considérable sur la pensée réformatrice de l’époque, et constituer un important terreau idéologique de la future Réforme protestante :
La Réforme en Allemagne, comme en Angleterre, fut un de ces moments où le christianisme se retrempa aux sources juives. Pendant ces années qui annoncent la Réforme, le Juif devint éducateur et enseigna l’hébreu aux savants, il les initia aux mystères de la Kabbale [la tradition mystique et ésotérique du judaïsme, NDLR], après leur avoir ouvert les portes de la philosophie arabe, il les munit, contre le catholicisme, de la redoutable exégèse que les rabbins avaient, durant des siècles, cultivée et fortifiée : cette exégèse dont saura se servir le protestantisme, et plus tard le rationalisme. […]
C’est l’esprit juif qui triompha avec le protestantisme. La Réforme fut par certains de ses côtés un retour au vieil ébionisme des âges évangéliques. Une grande partie des sectes protestantes fut demi-juive, des doctrines antitrinitaires furent plus tard prêchées par des protestants, entre autres par Michel Servet et par les deux Socins de Sienne. En Transylvanie même, l’antitrinitarisme avait fleuri dès le seizième siècle, et Seidélius avait soutenu l’excellence du Judaïsme et du Décalogue [la doctrine de la Trinité fut en effet l’un des principes théologiques les plus critiqués par les rabbins et le judaïsme, qui y voyaient un dévoiement du strict principe monothéiste, NDLR]. Les évangiles furent délaissés pour la Bible et pour l’Apocalypse. On sait l’influence que ces deux livres exercèrent sur les luthériens, sur les calvinistes et surtout sur les réformateurs et les révolutionnaires anglais. Cette influence se prolongea jusqu’au dix-huitième siècle même, c’est elle qui fit les Quakers, les Méthodistes, les Piétistes et surtout les Millénaristes, les Hommes de la Cinquième Monarchie qui avec Venner à Londres, rêvaient la république et s’alliaient avec les Niveleurs de John Lilburn. Aussi à ses débuts en Allemagne le protestantisme chercha-t-il à gagner les Juifs et, à ce point de vue, l’analogie est singulière entre Luther et Mahomet. Tous deux tirèrent leurs doctrines des sources hébraïques, tous deux désirèrent faire approuver par les débris d’Israël les dogmes nouveaux qu’ils dressaient. Ce n’est pas là, en effet, un des côtés les moins curieux de l’histoire de cette nation. Tandis que le Juif est détesté, méprisé, avili, couvert de crachats et de boue, souillé d’outrages, martyrisé, enfermé et frappé, c’est de lui que le catholicisme attend le règne final de Jésus, c’est le retour des Juifs que l’Église espère et demande, ce retour qui pour elle sera le suprême témoignage de la vérité de ses croyances, et c’est aussi aux Juifs que les luthériens et les calvinistes en appellent. Il semble même que ces derniers eussent été pleinement convaincus de la justice de leur cause si les fils de Jacob étaient venus à eux. Mais les Juifs étaient toujours le peuple obstiné de l’Écriture, le peuple à la nuque dure, rebelle aux injonctions, tenace, intrépidement fidèle à son dieu et à sa loi.
Bernard Lazare, L’Antisémitisme : son histoire et ses causes, pp. 140-142
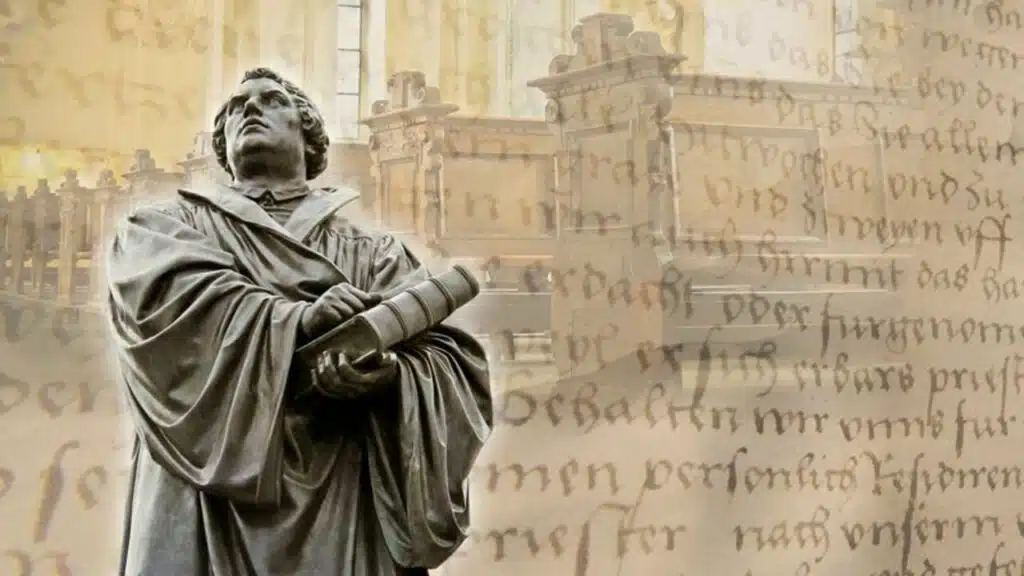





Pour revenir à notre Europe du XVIe siècle, il est à cet égard intéressant de relever que si le protestantisme restera évidemment une religion tout à fait distincte du judaïsme (et que très rares seront dans l’autre sens les Juifs qui se convertiront au protestantisme malgré les efforts menés tout particulièrement par Luther dans cette direction), les Juifs d’Europe trouveront dans les pays convertis massivement au protestantisme une tolérance religieuse et sociale et plus globalement une bienveillance qu’ils ne trouvaient alors nul part ailleurs. Suite à leur conversion de force puis expulsion d’Espagne et du Portugal à la fin du XVe siècle, les Juifs séfarades trouveront en effet dans les grands pays protestants comme la Hollande ou l’Angleterre une véritable terre d’accueil et de refuge – ces derniers allant même jusqu’à qualifier Amsterdam (puis plus tard Londres et les colonies britanniques d’Amérique du Nord – futurs États-Unis) de « Nouvelle-Jérusalem ». Des porosités se développeront également entre théologies et mysticismes protestants et judaïques, les calvinistes et les évangélistes réintégrant en particulier des éléments substantiels du messianisme juif, tandis qu’à la même époque, la Kabbale (la tradition ésotérique du judaïsme) pénétrera pour la première fois de façon significative les pratiques chrétiennes (pour les intéressé(e)s de ce sujet, je les renvoie en particulier vers les travaux du grand historien juif Gershom Scholem).
* * *
La démocratisation de l’accès à la prêtrise
L’un des autres principes fondamentaux et fondateurs du protestantisme est le sacerdoce universel. Reprenant une idée qui avait déjà été à la base du catharisme, Luther rejette le principe d’intermédiation divine à la base du fonctionnement du catholicisme (c’est-à-dire le monopole qu’exerce l’Église catholique dans l’accès à Dieu, ainsi que l’ensemble de privilèges que son appareil ecclésiastique en retire). Dans l’esprit du protestantisme, l’accès à Dieu devient direct et individuel, chaque homme ou femme a la possibilité d’accéder à la Divinité sans l’intermédiaire jusqu’ici indispensable des hommes d’Église. Luther estime en effet que le baptême met tous les Chrétiens à égalité et permet à tout chrétien d’exercer la fonction sacerdotale – autrement dit de devenir prêtre et de pouvoir prêcher. C’est d’ailleurs en ce sens que le protestantisme se traduit par une forme de « sécularisation de la religion », puisque dans la plupart des Églises réformées, il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une instruction de prêtre ou de moine pour pouvoir devenir pasteur et/ou pour pouvoir prêcher et réaliser des sermons. C’est à nouveau en ce sens que le protestantisme peut être considéré comme une forme de démocratisation de la fonction religieuse, désormais accessible potentiellement à tout chrétien ayant reçu le baptême.
Si nous parlons depuis le début de cet article « du » protestantisme et de « la » Réforme, il est en outre important de noter qu’il serait plus exact de parler « des » religions réformées. En effet, et à la différence du catholicisme (marqué par une grande unité doctrinale), ce que l’on nomme désormais la « religion réformée » est l’objet d’une grande hétérogénéité, caractérisée par une multitude d’églises et de variantes confessionnelles, chacune structurée autour de ses principes, de sa théologie et de son organisation spécifiques.
Si le luthérianisme et le calvinisme participent ainsi du même désir de renouer avec le supposé christianisme primitif et s’articulent autour des mêmes principes fondateurs, ils se distinguent en effet sur un certain nombre de points non-anecdotiques (modèle d’organisation, importance du concept de prédestination, place accordée aux traditions, importance de la dimension messianique et eschatologique, etc.). Et ces deux grands mouvements ne sont en fait que les deux les plus centraux : en pratique, la Réforme va se traduire, au cours des siècles suivants, par l’apparition d’une multitude de courants ; des courants qui naissent, se développent et meurent au gré des jeux d’influence et des scissions des uns avec les autres. Parmi ces courants majeurs de l’histoire protestante, on peut citer notamment : le luthérianisme, le calvinisme, l’anglicanisme, le presbytérianisme (l’église d’État de l’Écosse à partir du XVIIe siècle), le puritanisme (mouvement dont sont issus les fameux « Pères pèlerins » du Mayflower qui débarqueront en Nouvelle-Angleterre en 1620), le méthodisme (l’un des courants protestants comptant le plus de fidèles de nos jours), le baptisme (l’un des courants fondateurs du mouvement évangélique), le restaurationnisme (un courant messianique très influencé par le millénarisme et militant notamment pour le retour des Juifs en Terre Sainte), le frankisme (un courant judéo-protestant issu du messianisme sabatéen et marqué par son très fort antinomisme et ses importantes visées eschatologiques), le mormonisme, et encore des dizaines et des dizaines d’autres appelés à une plus ou moins grande postérité… !
C’est d’ailleurs cette absence caractéristique d’unité doctrinale et confessionnelle qui faisait dire à la fin du XIXe siècle au père jésuite Deschamps à propos du protestantisme (et cela dans une approche éminemment critique – ce dernier étant pour sa part un catholique intégriste !) :
Le Protestantisme n’est pas la religion, n’est pas une forme spéciale de religion, et pourrait être défini comme un mélange d’irréligion et de religiosité. Un homme qui se dit protestant ne fait pas connaître, par cette profession de foi, quelle est sa croyance, ni quelles sont les vérités qu’il admet, ni à quelles obligations il se soumet. On peut être protestant de beaucoup de façons différentes : les épiscopaliens, les méthodistes, les luthériens, les baptistes, les presbytériens sont autour de nous pour nous le dire. Le seul principe commun à tous est l’inspiration privée et la libre interprétation de la Bible, permettant à chacun de croire ou de rejeter ce que bon lui semble.
Nicolas Deschamps, Les sociétés secrètes et la société (tome 1), p. LXI
En résumé, alors même que l’Église romaine a œuvré durant des siècles à éliminer méthodiquement (et plus ou moins impitoyablement) toute doctrine jugée « divergente » ou contraire aux canons catholiques (c’est l’histoire de tout ce que cette dernière a nommé successivement les « hérésies » … !), le protestantisme pourrait être considéré à ce titre comme une « hérésie qui a réussie » (et qui se nourrit d’ailleurs très largement de toutes celles qui la précède !). Une hérésie qui a ensuite fait des petits, s’est multipliée, et qui aura ainsi, elle, indéniablement, fécondée l’Histoire.
L’organisation et le fonctionnement des Églises réformées
Suite à la diffusion des idées luthériennes, les premières Églises « réformées » apparaissent dès le début des années 1520 au sein du Saint-Empire romain germanique ainsi qu’en Suisse, à l’appel des prédicateurs du mouvement de Luther et de Zwingli. Il s’agit d’Églises nouvelles, séparées de Rome, organisées par les autorités politiques de villes libres ou d’États territoriaux (Saxe, Suède, etc.). Dans les villes comme dans les États « évangéliques », la communauté de base est la paroisse ou Église locale.
Comme nous l’avons évoqué, le nouveau clergé n’a rien à voir avec l’ancien clergé catholique : le clergé protestant est en effet « sécularisé » (c’est-à-dire marié et salarié) tout en étant fortement réduit, limité aux pasteurs ou aux « ministres » (serviteurs) de la parole. Les offices sont centrés sur la prédication biblique. Toute la liturgie, avec chant de l’assemblée, est en « langue vulgaire » (c’est-à-dire en langue du peuple) et non plus dans un latin inaccessible des masses. Les seuls sacrements – ceux considérés comme ayant été institués directement par le Christ – sont le baptême et la cène. Les lieux de culte sont vidés des statues, images et reliques des saints, et du saint-sacrement. Des conseils réunissant pasteurs et autorités laïques prennent en mains les programmes de réforme morale, l’instruction des enfants par l’école (politique d’alphabétisation), le catéchisme et le secours aux nécessiteux.
Concernant le nom de leurs nouvelles églises, les réformés se sont prévalus du mot « Temple » par allusion au temple de Jérusalem, une référence biblique qui rappelle que le sacrifice du Christ a mis fin au culte sacrificiel antique. À la différence de l’établissement catholique, le temple protestant n’est pas un espace sacré, mais la maison où les fidèles se réunissent pour écouter l’Évangile. Le bâtiment étonne souvent par sa modestie et son dépouillement ; l’art architectural ne devant pas substituer l’émotion artistique à l’émotion religieuse. Au nom du Décalogue, toute image concernant Dieu, Jésus-Christ, et surtout la Vierge et les saints (dont rien dans la tradition biblique ne permettrait d’établir le culte), est écartée du mobilier ecclésiastique. Le même rejet frappe eau bénite, scapulaire, cierges, cloches, et toutes les significations qui leur sont attachées. Le temple s’organise ainsi autour de la chaire, longtemps surélevée, au centre de l’espace cultuel. Une place essentielle est ainsi donnée à la Parole, entendue, écoutée, proclamée, prêchée. La table de communion complète le mobilier et souvent un verset biblique s’impose pour tout décor.



La Contre-Réforme (également connue sous le nom de Réforme catholique, de 1545 à 1700 environ) fut la réponse de l’Église catholique à la Réforme protestante, au cours de laquelle elle institua des réformes tout en s’efforçant de restaurer son ancienne centralité. L’un des aspects de ces efforts consistait à mettre l’accent sur l’art, l’architecture et la musique afin d’élever l’esprit des fidèles et de contraster fortement avec les églises austères des protestants qui avaient rejeté l’iconographie, la musique (à des degrés divers selon les sectes) ou toute représentation artistique de Jésus-Christ ou d’autres personnages bibliques.
Joshua J. Mark, « Dix choses à savoir sur la Réforme protestante », article traduit par Babeth Étiève-Cartwright pour la World History Encyclopedia

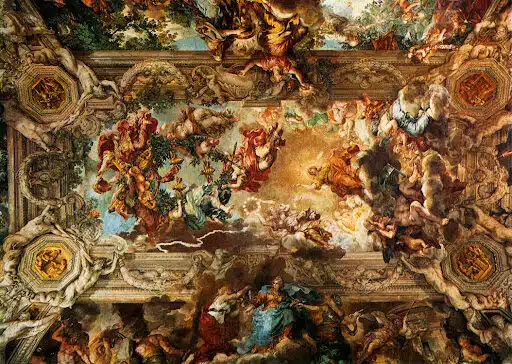
Même la croix, si centrale dans le culte chrétien, est touchée par la Réforme. L’usage de la croix latine dans la religion catholique et son utilisation magico-religieuse (signe de la croix, croix peinte sur les habitations, etc.) est en effet considéré par les protestants comme une superstition idolâtre, et rapidement banni. De façon générale, le protestantisme peut se percevoir et s’analyser comme le retour à un culte chrétien plus « rationnel » (voire rationnaliste), purgé des pratiques jugées païennes et superstitieuses – pratiques que le Christianisme romain avait justement eu l’habileté d’intégrer à son culte afin de se concilier avec les nombreuses traditions « païennes » des campagnes (magie, mysticisme, culte marial recyclant l’ancien culte très important de la Terre-Mère et de la Déesse-Mère, culte des Saints reprenant le principe de l’adoration des totems païens, etcetera etcetera).



L’Éthique protestante : responsabilité individuelle, alphabétisation généralisée et dynamisme économique
En fondant la doctrine du sacerdoce universel, la Réforme a donc rendu d’une certaine façon la parole au peuple. L’éthique protestante, fondée sur la responsabilité de l’individu, sollicite le chrétien réformé à assumer ses réflexions, ses décisions et ses actes. Ce faisant, celui-ci est appelé à « s’engager dans la création d’un espace de droit à la parole, à l’existence sociale ». Nombreux sont les historiens à avoir considéré en conséquence que le système d’organisation de l’église réformée calviniste (portant l’appellation lourde de « presbytérien synodal ») portait en lui les germes de la démocratie. Appliqué depuis le XVIe siècle, le système calviniste est en effet bâti sur une instance élue : le conseil d’anciens, désigné par l’assemblée cultuelle. Il comprend également des instances de représentativité au niveau national : les synodes régionaux et nationaux, où sont délégués des représentants des conseils d’anciens des églises locales. Un fonctionnement qui se pose donc en rupture radicale avec le fonctionnement pyramidal et structurellement élitiste de l’Église romaine, avec ses évêques « parachutés » dans les territoires sur décision de la Papauté (et souvent sur lobbyisme parallèle de la Royauté et des seigneurs locaux), et peu ou prou aucun système de représentation allant du bas vers le haut.
Même si Luther aurait lui rejeté le concept moderne de démocratie, le mouvement qu’il lança encouragea les idéaux démocratiques. Les œuvres de Luther contribuèrent à la guerre des paysans allemands au cours de laquelle la classe la plus modeste lutta pour obtenir l’égalité des droits et la représentation au sein du gouvernement, et les réformateurs qui suivirent Luther ont firent de même. Le réformateur suisse Heinrich Bullinger (1504-1575) plaida pour une direction démocratique de l’Église réformée, et le réformateur écossais John Knox (c. 1514-1572) fit de l’Église presbytérienne d’Écosse une démocratie. Comme les réformateurs protestants rejetaient la hiérarchie de l’Église catholique, ils s’orientèrent vers une structure politique et administrative plus égalitaire, codifiée par Jean Calvin dont les enseignements inspirèrent les croyances des puritains et des séparatistes, qui finirent par établir les colonies de la Nouvelle-Angleterre dans ce qui allait devenir les États-Unis.
Joshua J. Mark, « Dix choses à savoir sur la Réforme protestante », article traduit par Babeth Étiève-Cartwright pour la World History Encyclopedia
La Bible, traduite en langue vernaculaire, imprimée puis colportée, devient en outre, nous l’avons déjà bien souligné, la pierre angulaire de la piété populaire protestante. La lecture des Écritures est pratiquée de façon collective lors des offices religieux, mais innovation encore plus importante : elle l’est aussi quotidiennement au sein de la famille. La Réforme, en imposant la lecture de la Bible, va ainsi accomplir, dans tous les pays où le culte réformé s’enracine, un vaste travail d’alphabétisation (en allemand dans les pays germaniques, en anglais dans les îles Britanniques, en langue française dans les régions « réformées » de France, etc.). Bastion du protestantisme français, les Cévennes et leurs habitants développeront par exemple un goût pour la lecture qui constituera un sujet d’étonnement pour les étrangers à la région. En 1935, un inspecteur d’académie notera ainsi : « Les Cévenols lisent éperdument ». L’école laïque, dont les Cévennes constitueront aussi plus tard un bastion, se révélera de surcroit être un efficace vecteur de promotion sociale pour les paysans des montagnes. Mais l’impact de la Réforme dans l’évolution de la culture et des mœurs ne s’arrête pas aux seules questions socioculturelles, car le protestantisme va aussi avoir un remarquable impact sur l’économie des différents pays dans lesquels il s’est le plus largement enraciné.
Le christianisme médiéval avait en effet eu tendance à valoriser en quelque sorte la contemplation au détriment du travail manuel. Luther, puis Calvin rompent radicalement avec ce mépris à l’égard des activités séculières. En valorisant le quatrième commandement, les réformateurs rappellent ainsi le caractère impératif du travail sur six jours, tandis que dans le même temps, le repos hebdomadaire est sacralisé par le clergé protestant. Cette dignité nouvelle accordée au labeur des paysans ou aux tâches des artisans doit assurer la prospérité sur leur maisonnée, en référence à un texte célèbre de l’Ancien Testament : « …parce que tu écouteras le Seigneur ton Dieu : tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de ton ventre, le fruit de ta terre, le fruit de ton bétail, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénies » (Deutéronome 28, 2-5). Ce postulat d’une réussite matérielle considérée comme une bénédiction divine est aussi innovant que décisif : il a ainsi permis à des économistes tels que Max Weber (1864-1920) de rattacher éthique protestante et prospérité économique, et de tisser un lien historique entre les deux. Il est d’ailleurs éclairant de constater à ce sujet que les pays qui enregistreront les mutations et développements économiques les plus remarquables au cours des XVIe et XVIIe siècles (en particulier sur le plan du développement industriel et commercial) seront quasi-systématiquement des pays à majorité protestante (Provinces-Unies, Angleterre, Prusse,…) !
Dès le XVIe siècle, Olivier de Serres, agronome protestant du Vivarais, avait d’ailleurs revendiqué dans un ouvrage largement répandu, un libéralisme économique novateur : « …étant votre maison recognue pour celle de Dieu, Dieu y habitera y mettant sa crainte; et la comblant de toutes sortes de bénédictions vous fera prospérer en ce monde, comme est promis en l’écriture » (Le Théâtre d’Agriculture et Mesnage des champs, livre 1, 1600). Mais au-delà de cet encouragement à la prospérité agricole, ce seront surtout les métiers de la laine et du cuir (puis plus tard de la soie) qui hériteront de ce principe moteur et qui verront se développer, au cours des siècles suivant, un capitalisme huguenot particulièrement dynamique (dont la Hollande et sa capitale Amsterdam s’afficheront bientôt comme les premiers champions !).
En aparté : l’éthique protestante aux racines de l’essor du capitalisme et de la bourgeoisie modernes ?
Avec Jean Calvin, l’incitation au travail est renforcée par la notion de prédestination. Selon celle-ci, Dieu aurait choisi ceux qui seront damnés et ceux qui seront sauvés, sans que l’individu ne puisse rien y faire. Cette prédestination aurait constitué une grande source d’angoisse si elle n’était déchiffrable au cours de la vie terrestre par des signes tels que la réussite économique.
Extrait de la page Wikipédia consacrée à l’« Éthique protestante du travail »
La philosophie de la vie propre à la doctrine protestante a-t-elle constitué la matrice intellectuelle et culturelle du capitalisme moderne ? C’est une question fort intéressante, qui a travaillée de nombreux historiens et sociologues, et qui mérite de s’y attarder un moment.
L’idée d’un lien historique entre l’enracinement du protestantisme et le développement du capitalisme a été théorisée pour la première fois par Max Weber au début du XXe siècle, dans son ouvrage L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme, une œuvre fondatrice de la sociologie moderne. À la différence de Karl Marx qui situe les origines du capitalisme moderne dans l’évolution des conditions matérielles et des infrastructures (modes de production), c’est dans les questionnements théologiques sous-jacents à la Réforme (grâce, foi, salut) et dans l’évolution des mentalités religieuses induites par cette dernière que Weber voit l’acte de naissance de ce qu’il nomme « l’action économique capitaliste ». Pour comprendre cette analyse, il faut une nouvelle fois revenir à la place occupée par le travail dans la théologie protestante et au fameux concept de prédestination dont nous avons déjà parlé plus haut.
A contrario d’un christianisme « contemplatif », un luthérianisme et surtout un calvinisme encourageant le travail productif et la réussite matérielle
Comme le souligne Weber, Luther et les penseurs qui ont repris ses idées ont introduit une véritable transformation dans la représentation du travail et de l’activité professionnelle. Il faut bien avoir en tête qu’à l’époque où nous nous situons, la question du salut de l’âme et l’idée d’accéder à la vie éternelle obsèdent littéralement les populations et sont au centre des préoccupations spirituelles du corps social, du marchand au paysan. Or, dans la doctrine catholique de l’époque, la réussite professionnelle (et plus globalement la réussite matérielle dans le monde matériel) n’a pas valeur en soi pour la recherche du salut. La recherche du profit en tant que fin en soi (et non comme moyen de subsistance) est, au contraire, jugée amorale et contraire aux principes de charité chrétienne (le plus condamnable aux yeux de l’Église étant toutefois moins la possession de richesses que le fait de se reposer dessus et d’en jouir – d’où notamment l’interdiction de l’usure et le mépris des « rentiers » qui caractérisent le monde chrétien catholique). À l’inverse, le refus de la recherche des « biens du monde », voire la démarche de retrait hors du monde (par l’engagement monastique, le don aux bonnes œuvres, les pratiques de pèlerinage, d’ermitage…), sont valorisés, et même fortement encouragés par l’Église catholique en tant que voies de salut.
À rebours de cette valorisation de la pauvreté matérielle et de la contemplation (considérée à ce titre par certains penseurs protestants comme une valorisation de « l’oisiveté »), Luther et ses successeurs vont s’appuyer sur certains passages des Évangiles pour reconsidérer le rapport au travail et à la réussite matérielle, perçus désormais comme des signes de vertu et même comme une bénédiction divine. Les luthériens (puis encore davantage les calvinistes) considèrent en effet que le travail professionnel est une activité voulue par Dieu. La profession et le métier deviennent ainsi une activité consubstantielle à l’existence de l’Homme, une tâche que Dieu lui a donné à accomplir. Le travail n’est donc plus seulement un moyen de subsistance matériel : il devient aussi une valeur, presque une mission divine.
Pour Calvin, [la] société doit être essentiellement économique, tournée vers la productivité, dirions-nous aujourd’hui. « Il est requis, dit-il, pour nourrir les hommes en société et paix, chacun possède le sien, qu’il se fasse ventes et achats, que les héritiers succèdent à ceux qui doivent, que donations aient lieu et selon que chacun a industrie, vigueur, dextérité ou autre moyen, qu’il se puisse enrichir… en somme que chacun jouisse de ce qui lui appartient. » Quant au commerce, il convient de le réhabiliter : « la marchandise ne doit pas deux fois estre condamnée, veu qu’elle est profitable et nécessaire à la république ». Calvin est alors d’accord avec Luther pour mépriser la contemplation et proclamer que seul le travail est agréable à Dieu : « la bénédiction du Seigneur est sur les mains de celui qui travaille, il est certain que la paresse et oisiveté est maudite de Dieu ». Aussi condamne-t-il les moines avec autant de grossièreté que Luther : « la plus grande part d’entre eux parce qu’ils n’avaient de quoi se nourrir à la maison se sont fourrés dans des monastères comme dans des porcheries bien garnies ». Bien qu’il rejette ainsi la primauté du spirituel, le calvinisme prêche l’austérité, condamne toute espèce de luxe et de plaisirs inutiles, même les sports, les arts et la littérature car ils tendent à freiner les dépenses, à encourager l’épargne et travaille à l’accumulation du capital. La richesse n’est-elle pas pour les élus, une marque tangible et palpable de la bénédiction du Seigneur ? Se détournant ainsi de la Cité de Dieu, idéal proposé par Saint-Augustin à la société médiévale, voici qu’une partie dissidente du monde chrétien, pour qui l’« Ancien Testament » l’emportait sur le Nouveau, débouchait à présent sur la Cité de l’Or, la voie du puritanisme conduisant directement au capitalisme, c’est-à-dire à une forme de société dominée par l’Argent. Exploitant l’avantage obtenu sur le plan religieux et le désarroi d’une Chrétienté divisée contre elle-même, les nouveaux capitalistes n’allaient pas tarder à mettre en place, aux Pays- Bas d’abord, en Angleterre ensuite, des gouvernements à leur dévotion, chargés d’instaurer des régimes et un climat politique et économique favorables à leurs ambitions.
Jean Lombard, La face cachée de l’histoire moderne (tome 1) : la montée parallèle du capitalisme et du collectivisme, p. 119
Les « Élus » … et les autres

Ce renversement du rapport au travail et au monde matériel va de pair comme nous l’avons évoqué plus tôt avec la théorie de la prédestination, introduite déjà par Luther et qui va surtout prendre son essor avec la propagation de la pensée calviniste. En effet, Calvin reprend l’idée que le monde se diviserait entre élus et non-élus, entre ceux qui auraient reçu la grâce divine et ceux qui ne l’auraient pas reçu et qui ne l’auront donc jamais. Cette idée est absolument fondamentale, car elle se pose en rupture totale avec la doctrine catholique. Selon cette dernière en effet, Dieu accorde sa grâce (le « souffle divin ») à tous, et chacun est ensuite libre de faire le bien ou non. On obtient ainsi le salut par la foi, mais aussi (et surtout) par ses actes, par le « mérite des œuvres », qui peuvent même permettre de racheter une conduite jugée « mauvaise » et qui valait damnation (et donc privation de la vie éternelle). Au contraire, pour Calvin et les calvinistes, n’accéderont à la vie éternelle et au salut que les élus qui ont reçu la grâce, ce que ces derniers savent par leur foi et par le biais de certains signes, indépendamment de leurs actes :
Nous appelons Prédestination, le conseil éternel de Dieu, par lequel il a déterminé ce qu’il voulait faire de chaque homme. Car il ne les crée pas tous en pareille condition, mais ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à l’éternelle damnation. Ainsi selon la fin pour laquelle est créé l’homme, nous disons qu’il est prédestiné à la mort ou à la vie… […] Or comme le Seigneur marque ceux qu’il a élus en les appelant et justifiant, aussi, au contraire, en privant les réprouvés de la connaissance de sa parole ou de la sanctification de son Esprit, il démontre par tel signe quelle sera leur fin et quel jugement leur est préparé.
Calvin, Institution de la religion chrétienne (III, XXI, 5), De la prédestination.
Dans ce contexte où le protestantisme considère parallèlement le travail comme une tâche divine, la réussite professionnelle et matérielle apparaissent ainsi pour les croyants de la religion réformée comme des moyens de confirmation de son statut d’élu, à ceci près que ces derniers ne recherchent pas ces richesses pour elles-mêmes, ni ne cherchent à en faire l’étalage (les protestants – en particulier luthériens – se démarquant au contraire à l’époque par leur caractère austère voire ascétique). Si la recherche de profit n’est donc pas une fin en soi pour les calvinistes, elle cesse néanmoins d’être proscrite et jugée négativement par ces derniers, devenant au contraire un marqueur de réussite dans le travail et l’activité professionnelle, et ce faisant un signe de grâce et de bénédiction divines :
Si Luther a contribué à l’essor du rationalisme moderne, pour Weber, c’est dans le calvinisme que le capitalisme trouve sa véritable source. En effet, si Luther transforme la représentation du travail, il reste attaché à une vision conservatrice du monde. Le calvinisme exercera, lui, une influence proprement révolutionnaire. Weber en trouve l’origine dans les effets psychologiques exercés chez les fidèles par le dogme calviniste de la prédestination. Selon Jean Calvin, Dieu a de toute éternité destiné certains hommes au salut et condamné les autres à l’enfer (dogme du double décret ou de la prédestination). Le fidèle calviniste va alors chercher dans son activité professionnelle les signes de sa confirmation : la réussite dans la recherche des richesses lui semblera être le témoignage de son statut d’élu. Seuls, en effet, les élus peuvent avoir du succès dans l’activité que Dieu a donné à accomplir aux hommes pour sa plus grande gloire, c’est-à-dire dans le Beruf (la profession) comme vocation. Pour s’assurer de leur statut d’élu, les calvinistes vont ainsi transformer leur vie en une recherche méthodique des richesses dans le cadre de leur profession ; bien entendu, il est hors de question de transformer les richesses ainsi produites en luxe ou démonstrations ostensibles. C’est dans cette ascèse, centrée sur l’acquisition rationnelle de richesses, que le capitalisme trouvera selon Weber l’impulsion fondamentale à son essor.
Extrait de la page Wikipédia consacrée à L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme de Max Weber
Il est important toutefois de noter que la recherche de richesses matérielles et de réussite professionnelle qui caractérise une fraction importante des calvinistes n’est pas une quête d’accumulation individuelle de richesses. Autrement dit, les calvinistes ne cherchent pas spécialement à devenir riche en tant que fin en soi, ni à accumuler des fortunes et à vivre dans le luxe. Au contraire, ils font preuve d’un grand ascétisme en la matière, et ont plutôt pour pratique de réinvestir les richesses produites et/ou gagnées. Cette circulation de l’argent et des richesses (et non concentration et accumulation) aura justement pour effet de concourir au dynamisme économique des pays où ils sont significativement installés :
Weber remarque aussi que le protestantisme, celui de Luther, Calvin et des autres fondateurs de la Réforme est austère et s’oppose à toute recherche pour elles-mêmes des richesses, qui doivent être réinvesties, afin que l’argent circule et fructifie. Pour Weber, c’est dans cet esprit austère, ascétique qu’il faut chercher la source du capitalisme. […] Max Weber montrera que les entrepreneurs protestants, pour la plupart « parvenus » de l’artisanat, ont inventé un « capitalisme moderne » et inventif, prenant de vitesse des banquiers plus riches qu’eux, par l’intériorisation des bénéfices, en baissant les prix pour gagner de nouveaux clients, en dépensant pour adapter les produits et en sélectionnant les meilleurs travailleurs, quitte à payer plus cher et sacrifier la rentabilité à court terme. Ce capitalisme de l’ascèse, vise la croissance, au détriment de la rente et des plaisirs matériels. Il dérive du monachisme occidental, qui a pu rentrer dans le monde laïque grâce à la Réforme. Le protestant, ayant conquis le pouvoir politique notamment en Europe du Nord et dans les pays anglo-saxons, réinvestit ou intériorise ses bénéfices, pour donner à son peuple une place dans l’avenir et répondre à l’appel de Dieu à une vie éternelle, en espérant qu’il fait partie des élus secrets.
Extrait de la page Wikipédia consacrée au concept de la Prédestination
Il est évident que les églises réformées, avec leur sens de l’individu, de l’effort solitaire vers la perfection, de la valeur du travail et de la réussite bénie par Dieu, entretiennent chez les fidèles le goût de l’initiative et de la nouveauté économique et sociale. Que des sectes dissidentes donneront nombre de grandes dynasties industrielles bourgeoises et d’inventeurs : les Darby, grands métallurgistes, sont des quakers ; Watt est presbytérien ; les manufacturiers protestants de l’Alsace et des vallées vosgiennes contribuent largement à lancer la révolution industrielle en France.
Jean-Pierre Rioux, La révolution industrielle (1780-1880), p. 51
Une nouvelle vision du monde en phase avec les grandes mutations et dynamiques de l’époque
Par sa valorisation du travail professionnel, de l’exercice d’un métier qualifié, et de la réussite matérielle qui peut en découler, l’éthique protestante aura ainsi, selon toutes vraisemblances, participé à la création d’un environnement culturel favorable au développement du capitalisme moderne, qui connaîtra son grand essor surtout à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle dans les pays d’Europe occidentale (Pays-Bas, Italie, Angleterre, France, Espagne,…). L’essor du capitalisme marchand et financier (puis industriel à partir de la fin du XVIIIe siècle) ne saurait toutefois se réduire à la seule propagation et enracinement de « l’éthique protestante », cette dernière ayant probablement moins constituée la matrice absolue du capitalisme moderne qu’un terreau remarquablement favorable à son développement. En effet, si l’on constate dès le début du XVIIe siècle un différentiel de richesse moyenne entre catholiques et protestants en de nombreuses régions (particulièrement en France), il faut bien relever que le capitalisme n’a pas attendu l’arrivée du protestantisme pour commencer à se développer en Europe, comme en témoignent l’exemple des grandes villes marchandes italiennes de la fin du Moyen-Âge (Venise, Milan, Florence,…), ou la prospérité de la cité catholique d’Anvers :
Déjà, du Moyen-Âge à la Renaissance, le temps du marchand et des beffrois s’était substitué au temps de l’Église et de ses clochers, affirmant le passage des mondes agricoles au capitalisme commercial. Et Lewis Mumford a pu soutenir avec raison que l’horloge – et la montre, perfectionnée avec quel amour par les artisans du XVIIIe siècle ! – était la machine-clé de l’âge industriel moderne, plus que la machine à vapeur. Tout est mesurable, tout est interchangeable, tout est marchandise. Time is money.
Jean-Pierre Rioux, La révolution industrielle (1780-1880), p. 51


De façon générale, l’apparition du protestantisme coïncide historiquement avec la période du grand essor de la pensée mercantiliste, qui prône le développement économique des nations par l’enrichissement via le commerce extérieur, et qui encourage ce faisant le développement du commerce, de l’industrie adossée sur ce commerce et des activités marchandes. Ce nouveau courant de pensée économique, qui accompagne la découverte et la colonisation du Nouveau Monde, se développe considérablement au XVIe siècle dans toute l’Europe, où il prendra des formes différentes selon le pays (colbertisme en France, commercialisme aux Pays-Bas et en Angleterre,…). Il a néanmoins partout pour effet de contribuer à la résorption des valeurs religieuses et morales en ce qui concerne les considérations économiques (remettant notamment en cause le fait que l’usure soit un pêché, et positionnant l’enrichissement marchand comme une dynamique au service de l’intérêt général).
En fait, la pensée mercantiliste qui naît des (r)évolutions (techniques, maritimes, religieuses) de l’époque moderne est moins capitaliste que précapitaliste. En effet, contrairement au capitalisme (régime économique dont on rappelle qu’il se caractérise fondamentalement par la propriété privée des moyens de production), la pensée économique qui se développe partout au XVIe siècle se soucie moins de la richesse privée que de la puissance de l’État. Néanmoins, en ce qu’elle contribue à « promouvoir l’idée d’un développement volontaire, raisonné et construit de l’activité économique, en privilégiant les activités à rendements croissants, capables de dégager un surplus commercial lucratif », cette pensée suscite de nouvelles formes de développement économique qui préfigurent les évolutions futures. Les grandes compagnies commerciales privées comme les Compagnies des Indes, construites sur des principes de concentration de capitaux privés mais également de monopoles commerciaux conférés directement par les États, illustrent ainsi parfaitement cette idée de compromis entre mainmise de la puissance publique et enrichissement marchand. Participant donc lui aussi à la légitimation de la recherche du profit et à l’enrichissement marchand, le mercantilisme aura probablement autant contribué que le protestantisme à l’émergence du capitalisme dans l’Europe moderne (les deux phénomènes se seront à vrai dire vraisemblablement combinés, les protestants s’étant en effet largement spécialisés dans les métiers qualifiés – artisanat, négoce, banque, proto-industries,… – dont l’explosion du commerce international a provoqué un considérable essor).
Terminons enfin par noter que selon l’anthropologue Emmanuel Todd, la réceptivité des pays germaniques et anglosaxons au concept de prédestination défini par Calvin puis le fait que le capitalisme moderne soit né dans les régions à majorité protestante s’expliquerait moins par des raisons religieuses que démographiques et culturelles. En effet, selon Todd, certaines régions d’Europe ont été tentées par la doctrine de la prédestination parce que les structures familiales y valorisaient la valeur d’inégalité entre frères, très ancrée notamment via les systèmes d’héritage (dans la typologie qu’il a conceptualisée, ces systèmes de valeurs correspondent aux familles dite « nucléaire absolue » et « souche »). Ce sont ainsi ces structures familiales qui auraient ensuite influées sur le développement de ces régions (la famille nucléaire absolue étant théorisée par Todd comme un terreau remarquablement favorable à des innovations économiques réclamant le déplacement de nombreuses personnes des campagnes vers les villes, ce qui expliquerait l’industrialisation précoce des régions où cette famille est très présente comme en Angleterre et aux Pays-Bas, puis aux États-Unis). Selon les travaux de Todd, la « famille souche » possèderait de surcroît le plus grand potentiel de développement culturel, ce qui expliquerait l’alphabétisation précoce des régions allemandes (où ce type de famille est très présente) puis son succès économique enregistré à long terme grâce notamment au développement d’une main-d’œuvre plus qualifiée.
* * *
EN RÉSUMÉ, si on ne peut induire au seul protestantisme toutes les grandes mutations économiques qui caractériseront l’époque moderne, il est très important de prendre en tout cas pleinement la mesure de la portée phénoménale qu’auront les idées luthériennes et surtout calvinistes sur la société européenne, en particulier en matière d’évolutions socioéconomiques et de dynamiques macro-spirituelles.
Le renversement du rapport à l’usure : une (r)évolution anthropologique toute sauf anecdotique… !
Pour les raisons que nous avons vu, la doctrine protestante incite en effet plus ou moins directement à l’enrichissement individuel, tout en dévalorisant les bienfaits supposément divins des bonnes œuvres. Contrairement d’ailleurs à la doctrine catholique alors en vigueur, Calvin et le clergé protestant autorise l’usure (c’est-à-dire les prêts avec intérêts) jusqu’à un certain degré, se calquant notamment sur les pratiques déjà autorisées dans le judaïsme :
En dehors de son influence doctrinale, qui lui permettra de s’imposer en France aux Réformés, surtout à partir de 1550 (le premier synode national se réunira le 25 mai 1552) le calvinisme exerce une force d’attraction certaine sur les milieux d’affaires. Calvin, si austère par ailleurs, se montre en effet très compréhensif en matière économique. La suppression des entraves corporatives fondées sur la doctrine scolastique du juste prix, l’abrogation de la prohibition de l’usure par l’Église et même du prêt à intérêt, quelle aubaine pour les gens de négoce et de finance ! Les prescriptions du concile de Nicée de 775, condamnant l’usure et interdisant le prêt à intérêt avaient été répétées par les Conciles et notamment celui de Latran de 1179. Grégoire IX les avait inscrites dans ses décrétales en 1234 et le Concile de Vienne les avait reprises en 1311. L’année suivante, Clément V avait condamné les statuts municipaux qui tentaient de tourner ces décrets. Dans l’Antiquité, les philosophes, Aristote aussi bien que Platon, considéraient l’argent comme improductif (« argentum parere non posset »). À Rome, Caton et Cicéron dénonçaient les méfaits de l’usure qui avait provoqué tant d’émeutes populaires. Tour à tour, les Pères de l’Église, Saint-Ambroise, Chrysostome, et les scolastiques avaient adopté la même position intransigeante, que l’Université de Paris maintenait encore sans défaillance en 1532.
Certes les lois canoniques avaient connu quelques assouplissements. À titre de compensation du risque (« damnum emergens »), de manque à gagner (« lucrun cessant »), de participation aux profits, pertes et assurances (« trinus contractus »), une indemnité pouvait être versée. La commandite à la grosse aventure était autorisée. Allant plus loin que le droit romain qui permettait le prêt à intérêt (« usura ») et ne condamnait que l’usure (« foenus »), plus loin que les lois hébraïques qui n’interdisaient l’usure qu’entre Juifs, Luther condamnait encore l’usure. Là-dessus, Calvin – comme Melanchton et Bucer d’ailleurs –, est beaucoup plus souple. Disciple des juristes Pierre de l’Estoile à Orléans et Alciat à Bourges, placé dans l’intimité du riche marchand Pierre de la Forge à Paris et auprès des bourgeois de Strasbourg et de Genève, au contact des réalités économiques, il a des idées très précises en la matière. […] Rejetant la thèse d’Aristote sur l’improductivité de l’argent, Calvin partage les idées de son ami légiste Charles Dumoulin, exprimées en 1546 dans son « Tractatus contractura et usurarum » en faveur du prêt à intérêt, car il considère l’argent comme le plus fructueux « es marchandises ». Distinguant le prêt à la consommation du prêt à la production, il en arrive à renverser la loi antique : « je conclus maintenant qu’il faut juger des usures non point selon quelques certaines particulières sentences de Dieu mais seulement selon la règle d’équité ». « Attendu que les hommes ne peuvent pas autrement trafiquer et négocier les uns avec les autres, il faut toujours prendre garde à ce qui est licite » (Révélation du prophète Ezéchiel, Genève, 1555). Autrement dit, ce qui était interdit, sauf exception, devient licite… dans de certaines limites d’ailleurs fort difficiles à maintenir. […] Ainsi se trouvait abattue la principale digue qui retenait la société sur la voie du capitalisme.
Jean Lombard, La face cachée de l’histoire moderne (tome 1) : la montée parallèle du capitalisme et du collectivisme, pp. 117-118
Les réformateurs proposent une révision majeure de l’éthique économique. L’argent n’est plus sale ; il est permis de le faire travailler, Calvin autorise les pasteurs à pratiquer le prêt à intérêt en raison des « pieux loisirs qu’il dispense aux ministres du culte ». Exactement ce que disent les rabbins depuis quinze siècles ! C’est un changement radical pour la Chrétienté : au-delà des premiers banquiers catholiques, plus ou moins dissimulés comme marchands, les prêteurs juifs se trouvent désormais face à une concurrence ouverte et directe : celle des protestants, et, bien vite, pas seulement des pasteurs.
Jacques Attali, Les Juifs, le monde et l’argent : Histoire économique du peuple juif, p. 287
Il y a une idée très importante : la prohibition de l’usure n’a historiquement pas qu’une raison religieuse, mais avant tout un rôle social. Depuis Caton l’Ancien, le crime le plus grave qui soit, c’est l’usure, parce que globalement – c’est le thème de Crime et Châtiment – de l’usure procède globalement tous les méfaits possibles (quand vous êtes ruiné vous êtes prêt à tout !). C’est la raison pour laquelle il y avait eu une condamnation de l’usure par l’Église catholique. Or, dans le contexte de la Réforme, vous allez voir une influence juive (et c’est historiquement documenté que les Juifs ont été un facteur lourd dans la naissance du capitalisme dit moderne, y compris avec ses excès spéculatifs). […] Et donc vous avez eu dans ce contexte-là le développement d’un protestantisme initialement luthérien (qui était critique pour des raisons légitimes de la Papauté) qui a lui-même fait l’objet d’un débordement calviniste, dans un contexte où ce dernier était très favorable au libre commerce et donc aux abus qui par définition allaient l’opposer aux États dans leur fonction de protection du peuple. […] Cela doit vraiment être considéré comme une idéologie, un courant de pensée matérialiste, c’est pourquoi le sujet n’est pas vraiment le rôle des Juifs mais les luttes d’influence internes au sein du judaïsme. Vous avez globalement ainsi des Juifs (comme récemment le rabbin Yaron Reuven) qui reprochent à d’autre Juifs leurs excès matérialistes et vous avez en réalité toujours eu ces luttes d’influences-là depuis la Bible (Isaïe faisait déjà le procès d’un clergé qui confondait un peu le Temple et les banques ; Jean-Baptiste et Jésus ont fait pareil).
Extrait de l’entretien intitulé « Cinq siècles de subversion internationaliste » donné par Jean-Maxime Corneille sur la chaîne Youtube du magazine Géopolitique Profonde en décembre 2023
À la faveur de la Réforme religieuse, une révolution financière et commerciale est en cours, qui va bientôt s’étendre au domaine social et politique. Dès le milieu du XVIIe siècle, l’influence morale des [réfugiés juifs de la péninsule ibérique] est telle dans les Pays-Bas que juristes et philosophes donnent comme modèle de la constitution hollandaise les lois des anciens Hébreux. Une idée domine ce système : l’idée de contrat (berit❜h en hébreu). De même que la tradition mosaïque a imposé la notion d’un contrat qui lie Iahvé au peuple élu, de même que chaque membre de la communauté considère qu’une sorte de compte-courant lui est ouvert dans le ciel, de même le principe d’un contrat entre l’individu – le citoyen abstrait – et l’État doit s’introduire dans le monde moderne. Ce sera l’œuvre de la révolution puritaine.
Jean Lombard, La face cachée de l’histoire moderne (tome 1) : la montée parallèle du capitalisme et du collectivisme, pp. 130-131


Le matérialisme n’est d’ailleurs pas le seul principe que le calvinisme emprunte au judaïsme. En effet, le concept de prédestination popularisé par Calvin est fondamentalement un concept d’élection, avec l’idée que la société se diviserait entre les élus (touchés par la grâce et qui accèderont eux à la vie éternelle), et les autres (condamnés à demeurer pêcheurs et damnés toute leur existence quels que soient leurs actes et bienfaits en ce monde). Cette idée d’élection reprend le concept de « peuple-élu » qui est aux fondements mêmes du judaïsme, à ceci près que la différenciation entre élus et non-élus ne se fait donc plus selon un critère ethno-racial (le judaïsme se considérant selon sa propre définition théologique issue du Talmud comme un « peuple-race ») mais selon un critère de réussite économique et sociale.
Une pensée calviniste de facto remarquablement favorable aux intérêts de la bourgeoisie montante
Ces conceptions de la foi et du salut ne relèvent pas du tout du détail, et constituent à vrai dire pour l’époque une véritable révolution politico-religieuse, et qui va avoir un immense impact en matières d’évolutions sociétales ! En effet, considérées dans cette perspective, les conceptions théologiques propres au protestantisme vont contribuer à donner à la bourgeoisie de la Renaissance une forme de blanc-seing à l’accumulation de richesses, désormais perçue comme un signe de grâce divine. Cela va même encore plus loin, car le calvinisme ne se contente pas de légitimer des pratiques qui, dans les faits, se rapportent à la bourgeoisie : il tend carrément à positionner cette dernière comme rien de moins que la « classe élue » !
Dans ce monde brutal, régi par les rapports de force, la monnaie apparaît peu à peu comme une forme supérieure d’organisation des relations humaines permettant de régler sans violence tous les conflits, y compris d’ordre religieux. Les auteurs du Talmud, pour la plupart marchands eux-mêmes, sont souvent des experts en économie […]. Mais la richesse n’est pas une récompense : c’est une charge. Le riche n’a pas à s’excuser de l’être ; il doit seulement prendre une plus grande part de responsabilités dans la gestion du monde […].
Jacques Attali, Les Juifs, le monde et l’argent, pp. 124-125
En effet, en différenciant les Chrétiens entre élus et non-élus (une conception fondamentalement inégalitaire de la société humaine), et en basant parallèlement le critère de différenciation sur la réussite économique et sociale, le logiciel luthérien – et encore davantage le logiciel calviniste – tend à désigner la Bourgeoisie comme la population la plus ostensiblement touchée par la grâce divine. Et donc, en quelque sorte, à faire de cette dernière la nouvelle « classe élue », en lieu et place de l’aristocratie (qui, jusque ici, bénéficiait plus ou moins de cette perception dans la société chrétienne). C’est d’ailleurs en ce sens que des penseurs modernistes (comme l’historien de l’économie britannique R. H. Tawney) ont précisément vu en Calvin le « Prophète de la Bourgeoisie », et dans le calvinisme, plus globalement, la vision du monde et la philosophie de la vie qui devaient, plus que toutes autres, servir de fondations à l’appareil idéologique de la Bourgeoisie et de la classe possédante de l’époque moderne.
Le calvinisme était une doctrine religieuse bourgeoise taillée pour le commerçant et le banquier. Calvin enseigna à cette bourgeoisie à se sentir comme un peuple élu, la rendit consciente de sa grande destinée à accomplir selon le destin de la Providence, et résolue à l’accomplir.
Youssef Hindi, dans son article « Russie-Occident : un choc pluridimensionnel »
En résumé : des idéologies nouvelles sécrétées par un monde nouveau
Somme toute, c’est donc une véritable philosophie globale de la vie religieuse – et par extension une philosophie de la vie et de la société – qu’incarne le calvinisme. Une théosophie qui, en se croisant et se coagulant avec d’autres grands mouvements de pensée de l’époque (humanisme, mercantilisme, libéralisme, messianisme, millénarisme,…), semble in fine avoir constituée, il faut bien le dire, la grande matrice idéologique de la bourgeoisie libérale de l’époque moderne (cette bourgeoisie qui, rappelons-le, va connaître un immense essor à partir du début de la Renaissance, et qui s’attachera bientôt à conquérir le pouvoir politique que semble légitimer de son point de vue son pouvoir économique croissant).
Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que la légitimation de la bourgeoisie et de l’accumulation capitalistique de richesses faisait partie des desseins initiaux de Luther et de Calvin. Cependant, il demeure indéniable que la religion et le corpus idéologique que ces derniers auront forgés (ainsi que les dynamiques sociales, culturelles et économiques que la diffusion et l’enracinement du protestantisme engendreront à moyen terme), offriront à la bourgeoisie européenne de la Renaissance une légitimité sans pareille, et au capitalisme, un cadre et un environnement éminemment favorable à son développement.
Les guerres de Religion : quand le protestantisme déchire l’Europe
De 1562 à 1598, huit guerres de Religion provoquent une crise sans précédent. En 1598, l’édit de Nantes instaure un régime de tolérance civile, avec l’autorisation du culte protestant. Mais, à partir de 1610, se met progressivement en place une politique qui vise à anéantir le « parti huguenot ». Le rétablissement du catholicisme en Béarn envenime les relations entre Louis XIII et les princes réformés. De 1621 à 1629, se déroulent les dernières « guerres de la Religion » dites de Rohan. La paix d’Alais, en 1629, ruine le parti huguenot.
Jean-paul Chabrol et jacques Mauduy, Atlas des Camisards, p. 9
À la fin du XVIe siècle, la chrétienté occidentale est donc devenue plurielle. Les diverses confessions (luthérienne, calviniste, anglicane, catholique) se territorialisent, notamment en Allemagne, selon le principe du Cujus regio, ejus religio (« À chaque région, sa religion »). Les constructions confessionnelles étatiques divisent désormais l’Europe. Certains historiens ont à ce titre développé le concept de « confessionnalisation » pour désigner cette réalité nouvelle.
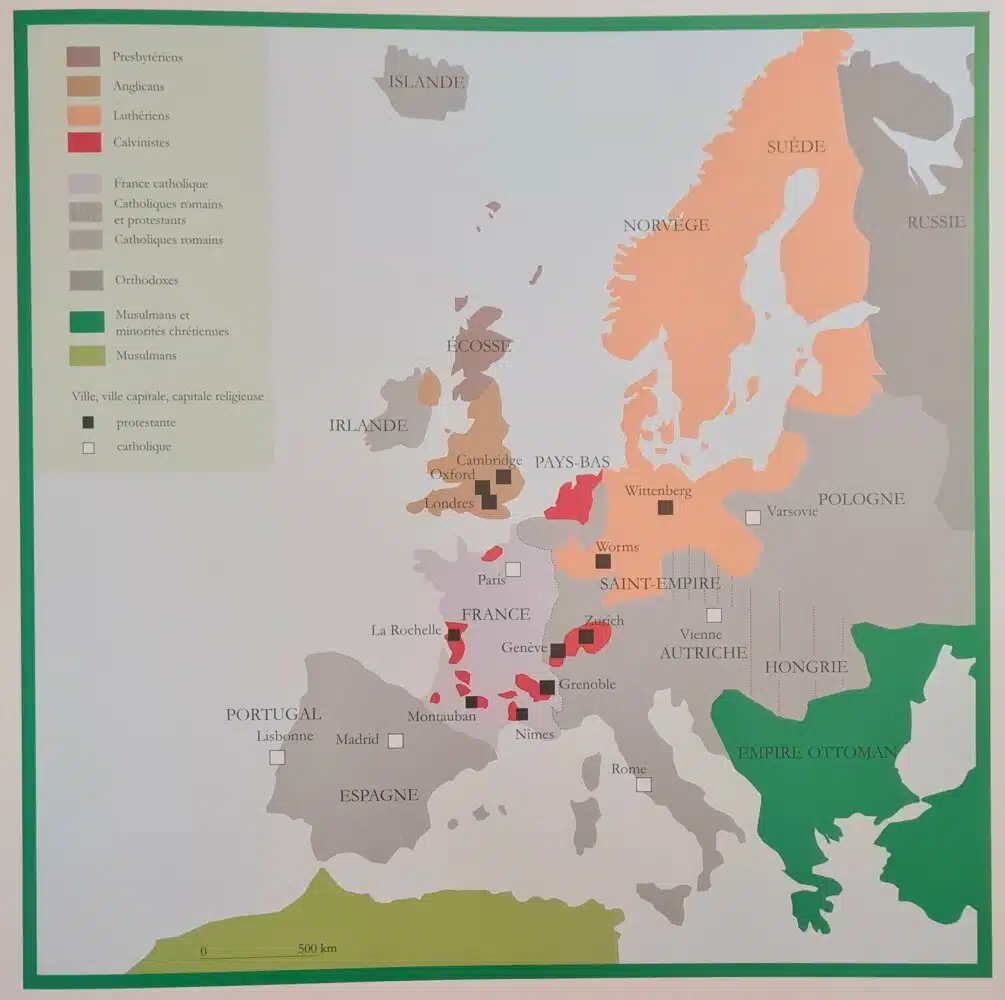
(source : Atlas des Camisards, p. 19)
Dans la partie septentrionale du Saint-Empire romain germanique et le monde scandinave, prédominent les États luthériens. Rois ou princes ont la main sur la direction ecclésiastique des Églises. En Angleterre, nous l’avons vu, la rupture avec la Papauté a abouti à la naissance d’un État anglican. Les États calvinistes (les Pays-Bas et l’Écosse) se sont pour leur part calqués sur l’organisation ecclésiale de la Genève de Calvin et de Théodore de Bèze, une « république » qui fait la part belle au consistoire réunissant pasteurs et laïcs. Partout ailleurs, les calvinistes se trouvent à l’intérieur d’États catholiques (la France) ou luthériens (l’Allemagne) où ils s’organisent, eux aussi, sur le modèle calviniste.
L’unité religieuse qui peut ressortir de cartes comme celle de droite ne doit cependant pas faire illusion. Dans chaque État européen, quelle que soit la confession dominante, existent ici et là des minorités religieuses, plus ou moins nombreuses, plus ou moins tolérées, plus ou moins reconnues, plus ou moins brimées et persécutées. À une époque où la tolérance (telle que nous l’entendons depuis Voltaire) n’existe pas, le sort des minorités et des dissidents est souvent précaire, menacé par le rêve vain d’assurer une unité confessionnelle à l’intérieur d’un territoire, d’une région ou d’un État. Très tôt, en Allemagne d’abord, s’est posée la question du pluralisme religieux, de la coexistence confessionnelle entre religions désormais rivales. En 1555, la paix d’Augsbourg imposée par Charles Quint (elle met fin aux hostilités entre les États luthériens et les États catholiques en Allemagne) a permis la coexistence des deux religions (luthérienne et catholique), bien que les autres ne soient pas reconnues. En France, en revanche, la coexistence entre des Protestants minoritaires et des Catholiques surmajoritaires (exceptés au sein de quelques territoires méridionaux) va demeurer un vœu pieu. Pire : elle va se traduire par trois décennies de violentes guerres civiles, qui vont littéralement déchirer le pays et qui resteront dans les mémoires comme les années les plus noires qu’aient probablement jamais connues la France.
Ces conflits entre Catholiques et Protestants français, incomplètes à offrir aux seconds un véritable statut de citoyen à part entière, libre de culte et reconnu civilement, connaitront à ce titre encore plusieurs résurgences durant les deux siècles suivants. En fait, les conflits de religion et la persécution des protestants français ne trouveront leur fin définitive qu’avec l’édit de Tolérance de 1787 et surtout la célèbre Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de la Révolution française (qui reconnaîtra enfin les minorités religieuses comme des citoyens à part entière et leurs droits civils). Mais ceci est une autre histoire… 😉
Zoom sur : la diaspora huguenote consécutive aux guerres de religion (et surtout à l’abolition de l’édit de Nantes de 1685)
Demeurant globalement minoritaire en France à la différence de l’Angleterre ou des États allemands voisins, la « religion réformée » s’implantera et se diffusera surtout dans les régions du Midi, en particulier en Gascogne, dans le Languedoc, dans le Dauphiné ainsi que dans le Poitou. Certaines villes de ces régions joueront le rôle de « places de sûreté » durant les guerres de religion, où les protestants persécutés du pays pouvaient se réfugier et exercer plus librement leur culte. Parmi ces « bastions protestants », La Rochelle constituera longtemps un point d’appui décisif du parti huguenot (jusqu’à être assiégée et définitivement matée par un certain cardinal de Richelieu en 1628).
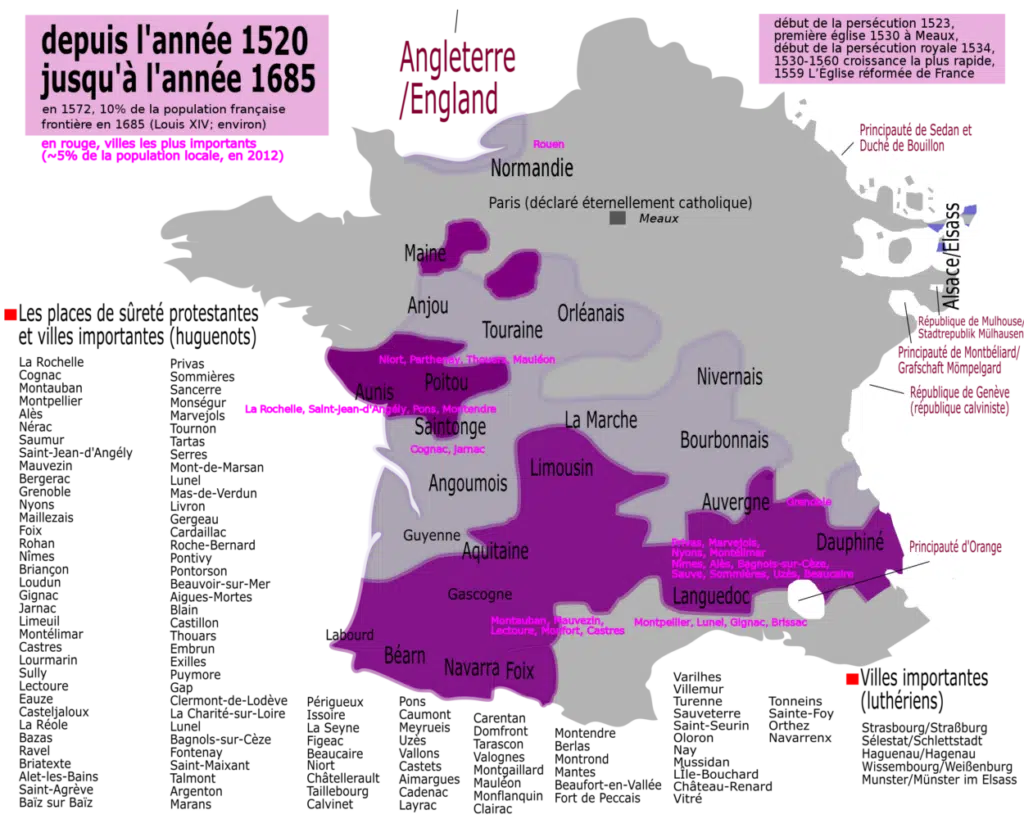


Après un siècle d’accalmie permis par la (relative) tolérance religieuse instaurée par l’édit de Nantes, son abolition en 1685 par Louis XIV et sa politique de conversion forcée (marquée par les célèbres et terribles dragonnades) bouleversera le fragile équilibre religieux du royaume catholique et entraînera un exode massif des protestants français. En l’espace d’une décennie, on estime ainsi que ce sont entre 150 000 et 200 000 huguenots qui auraient quittés la France, principalement pour s’établir en Allemagne (notamment à Berlin où le roi de Brandebourg-Prusse les invite à s’implanter) et surtout en Angleterre et dans les Pays-Bas (sans compter les milliers d’entre eux qui gagneront également le Nouveau Monde, notamment les colonies de Nouvelle-Angleterre et de Nouvelle-Néerlande).
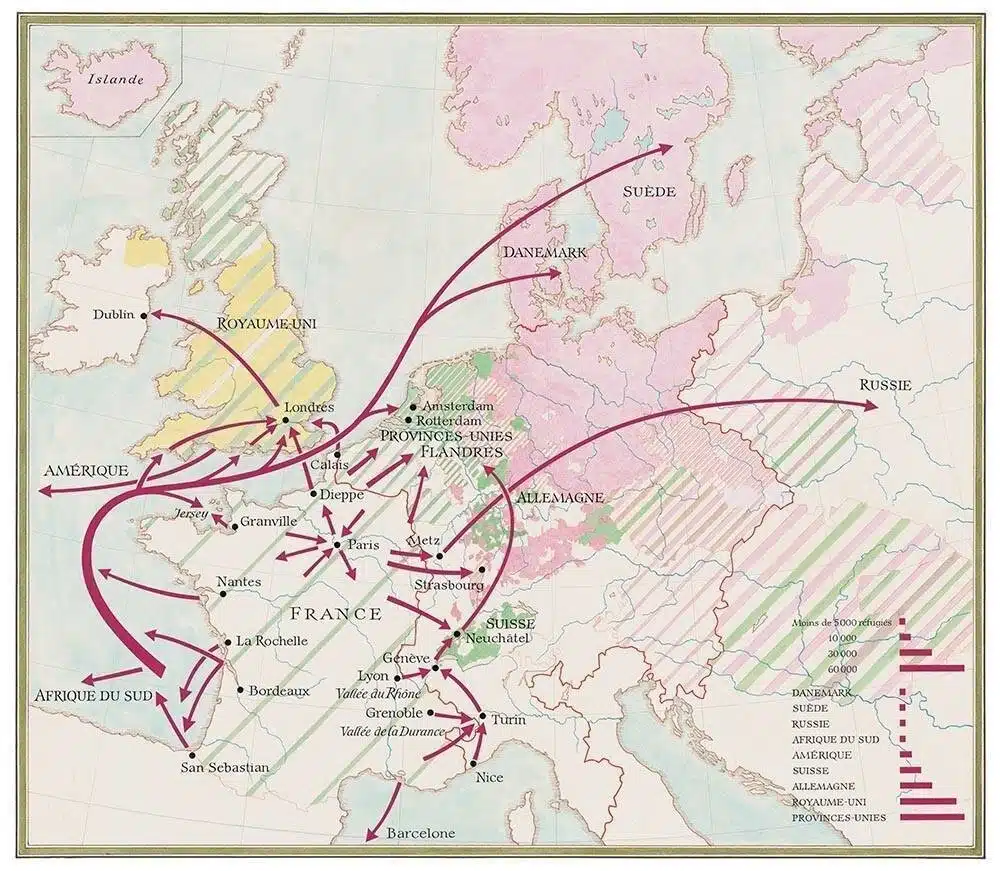
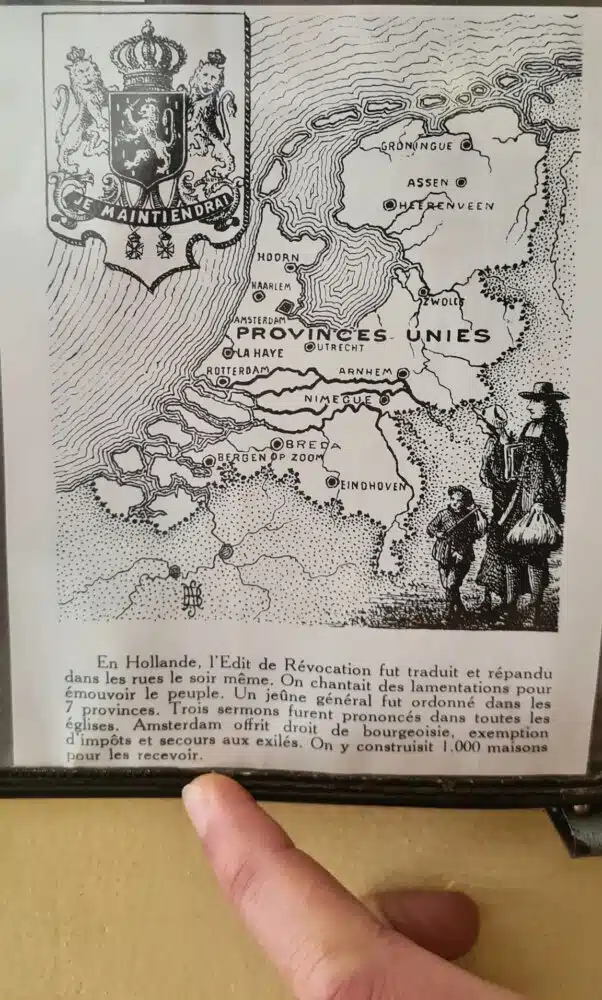
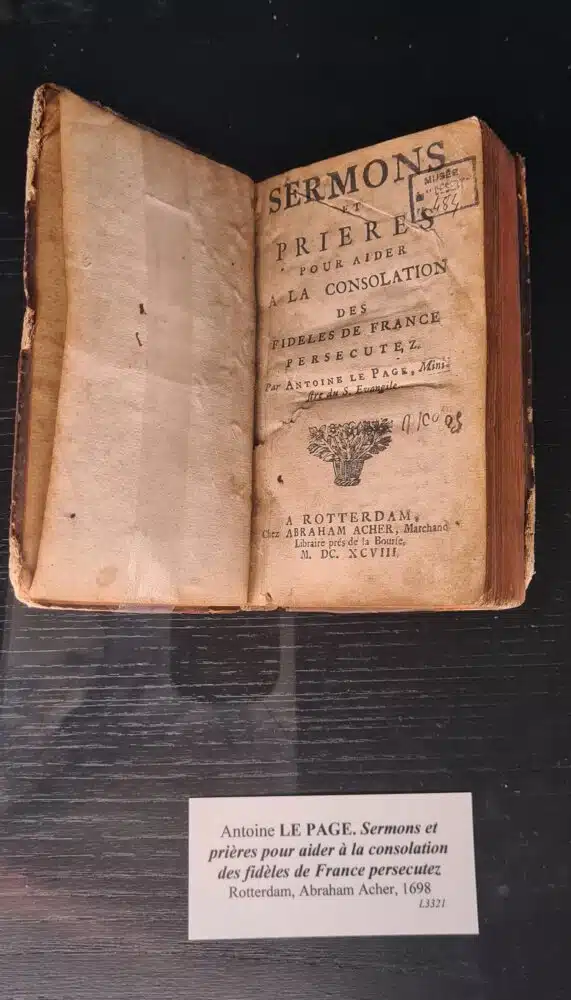
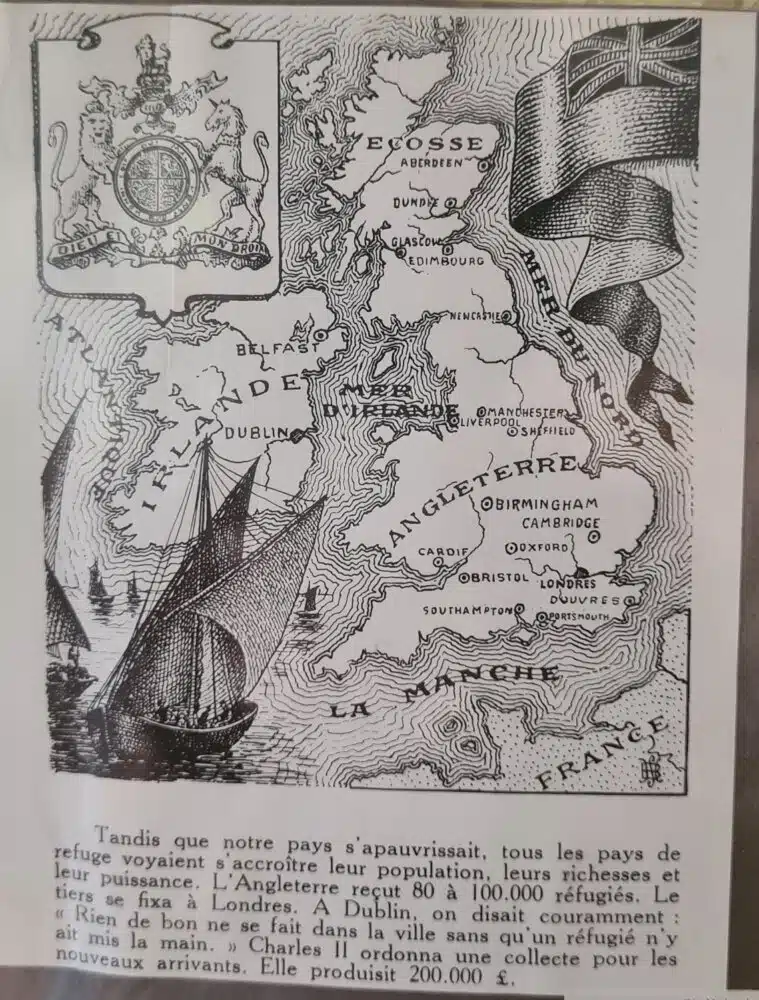


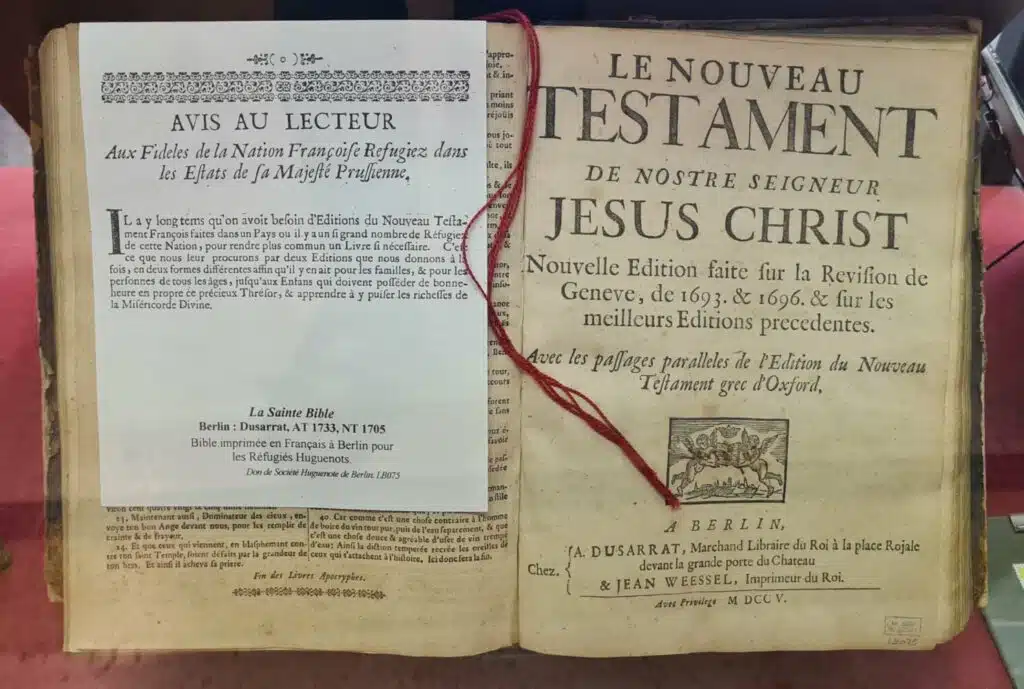
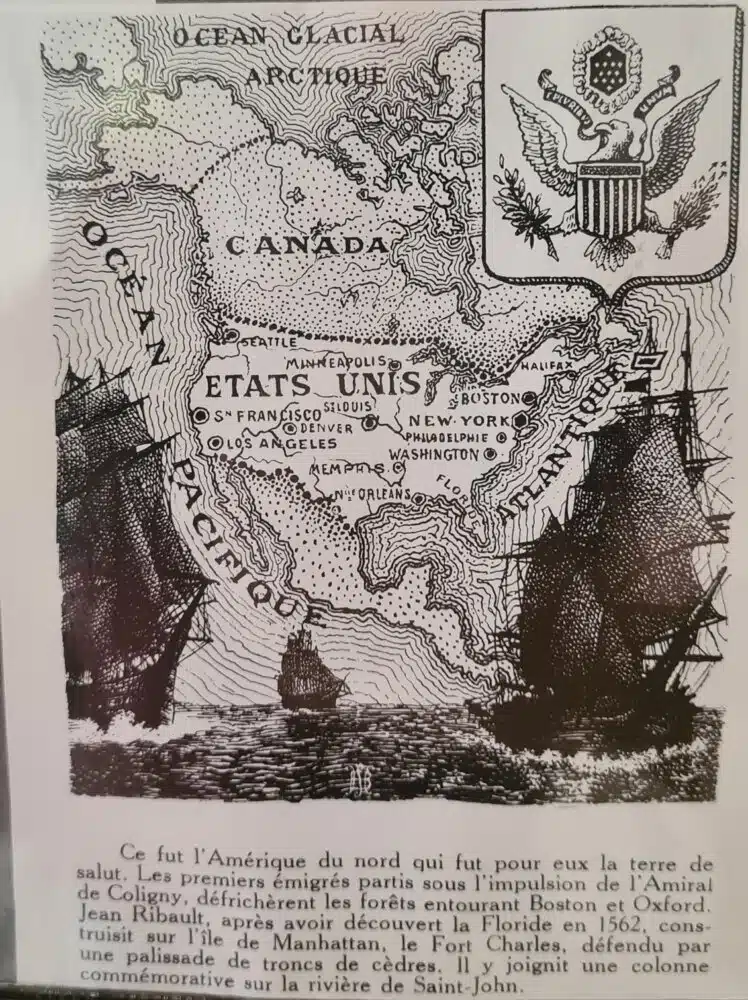
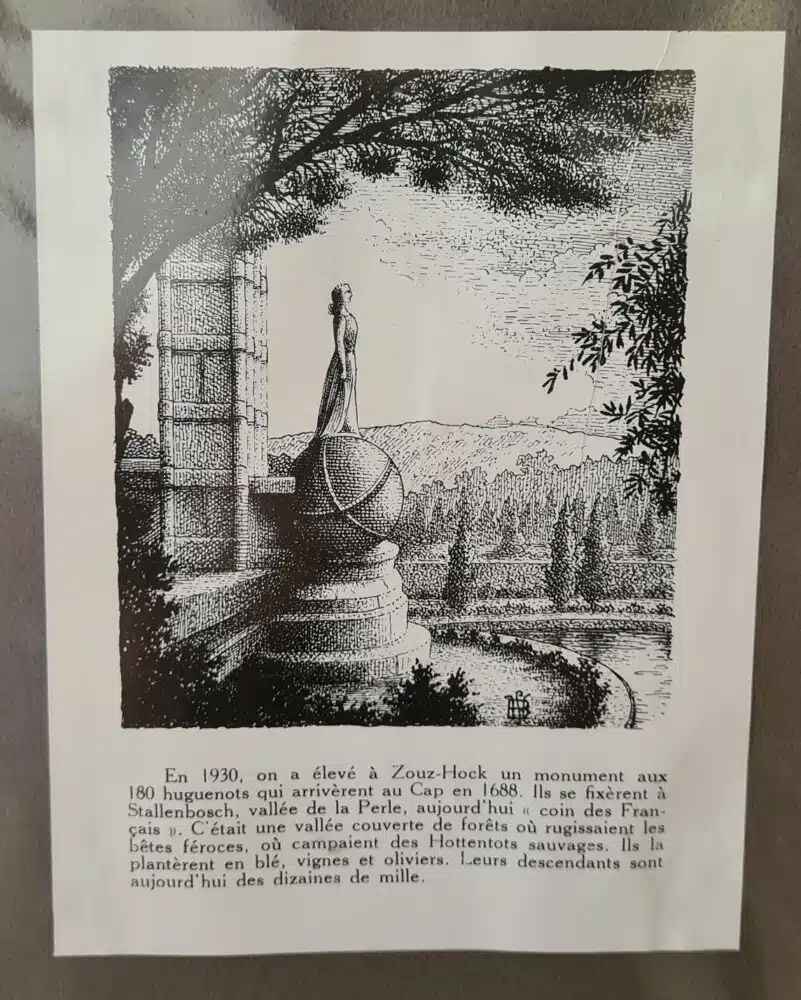


Grâce à leur niveau culturel plus élevé que la moyenne et leur excellence dans les domaines de l’orfèvrerie, du textile, de l’horlogerie, de l’ébénisterie ou encore de l’imprimerie, les huguenots constitueront un apport décisif à l’économie et aux sociétés des pays où ils se sont exilés (en particulier aux Pays-Bas et en Angleterre). Rétrospectivement et sur le long terme, l’éviction des protestants de France ne constitua ainsi probablement pas la décision économique et stratégique la plus judicieuse de Louis XIV – même si elle fut en partie compensée par l’arrivée de 40 000 catholiques britanniques et irlandais à peu près au même moment (et pour les mêmes motifs de persécutions dans leur pays) … !
*
* *
Pour aller plus loin… 🔎🌎
Ce petit épisode de la série des « Il était une fois… » du blog sur l’histoire de la Réforme et la naissance et l’enracinement du protestantisme est en fait extrait de ma grande série consacrée à l’affaire de la Bête du Gévaudan. Je renvoie ainsi les passionné(e)s de grandes énigmes historiques vers cette vaste fresque documentaire sur l’histoire incroyable (mais vraie) de cette célèbre « Bête dévorante » de l’histoire de France. Une histoire extraordinaire qui, loin d’une simple légende, a fait plus d’une centaine de morts dans le territoire correspondant à l’actuel département de la Lozère, et a profondément marqué les mémoires des paysans de ces hautes et rudes terres du Massif central à la croisée du Languedoc et de l’Auvergne (affaire où la question de l’ancienne organisation territoriale et administrative de la France d’Ancien Régime fut d’ailleurs centrale !).
L’histoire extraordinaire d’un fait divers devenu haute affaire d’État, et qui aboutira notamment à l’organisation des plus grandes battues de l’histoire du Monde jamais réalisées contre un animal féroce.
L’histoire extraordinaire de trois années de terreur paysanne et de cauchemar grandiose constituant la plus grande énigme du règne de Louis XV, et qui a traumatisé tout un territoire comptant alors parmi les provinces les plus pauvres et les plus reculées du royaume de France (et dont la Bête est devenue l’emblème).
Une histoire extraordinaire qui, au-delà de la résolution du mystère, a également beaucoup à nous apprendre sur la société et la France de l’Ancien Régime, entre crépuscule de la Royauté et montée en puissance des Lumières, entre condition et vie paysannes dans les hautes terres et quotidien de Cour, ainsi que sur l’histoire et la géographie d’une région d’une sauvage beauté, et qui correspond aujourd’hui globalement au département de la belle et secrète Lozère…
* * *
Et sinon, pour les intéressés et autres curieux, vous pouvez prendre connaissance de tous mes articles, (photo)reportages, récits de voyage, documentations et cartes liés à plus globalement à l’histoire, à la géographie ainsi qu’au patrimoine (naturel, architectural, culturel) de la France (de l’Antiquité à nos jours), en consultant mes rubriques respectivement dédiées à ces domaines – notamment sa riche cartothèque (accessibles ici : catégorie « Histoire de France » et catégorie « Géographie de France »).
Et si d’autres sujets et thématiques vous intéressent, n’hésitez pas également à parcourir ci-dessous le détail général des grandes catégories et rubriques du site, dans lesquels vous retrouverez l’ensemble de mes articles et cartes classés par thématique. Bonne visite et à bientôt !
Afrique Allemagne | Prusse | Autriche Amériques & Caraïbes Anciennes civilisations Ancien Régime Angleterre | Grande-Bretagne | Royaume-Uni Antiquité Asie Canada | Québec Culture(s) Economie Epoque contemporaine Epoque moderne Espagne | Portugal Etats-Unis Europe France Gaulois | Celtes Grèce Grèce antique Géographie Histoire de France Histoire du Monde Italie Lozère & Cévennes Monde Moyen-Âge Méditerranée Nature & Environnement Nouveau Monde Patrimoine(s) Pays-Bas Politique Préhistoire Religion Rome antique Russie | URSS Révolution(s) Seconde guerre mondiale Société(s) Urbanisme Voyage
Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et documentés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).
Merci, chaque soutien, chaque petit euro, me permet de vivre et est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂
Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee